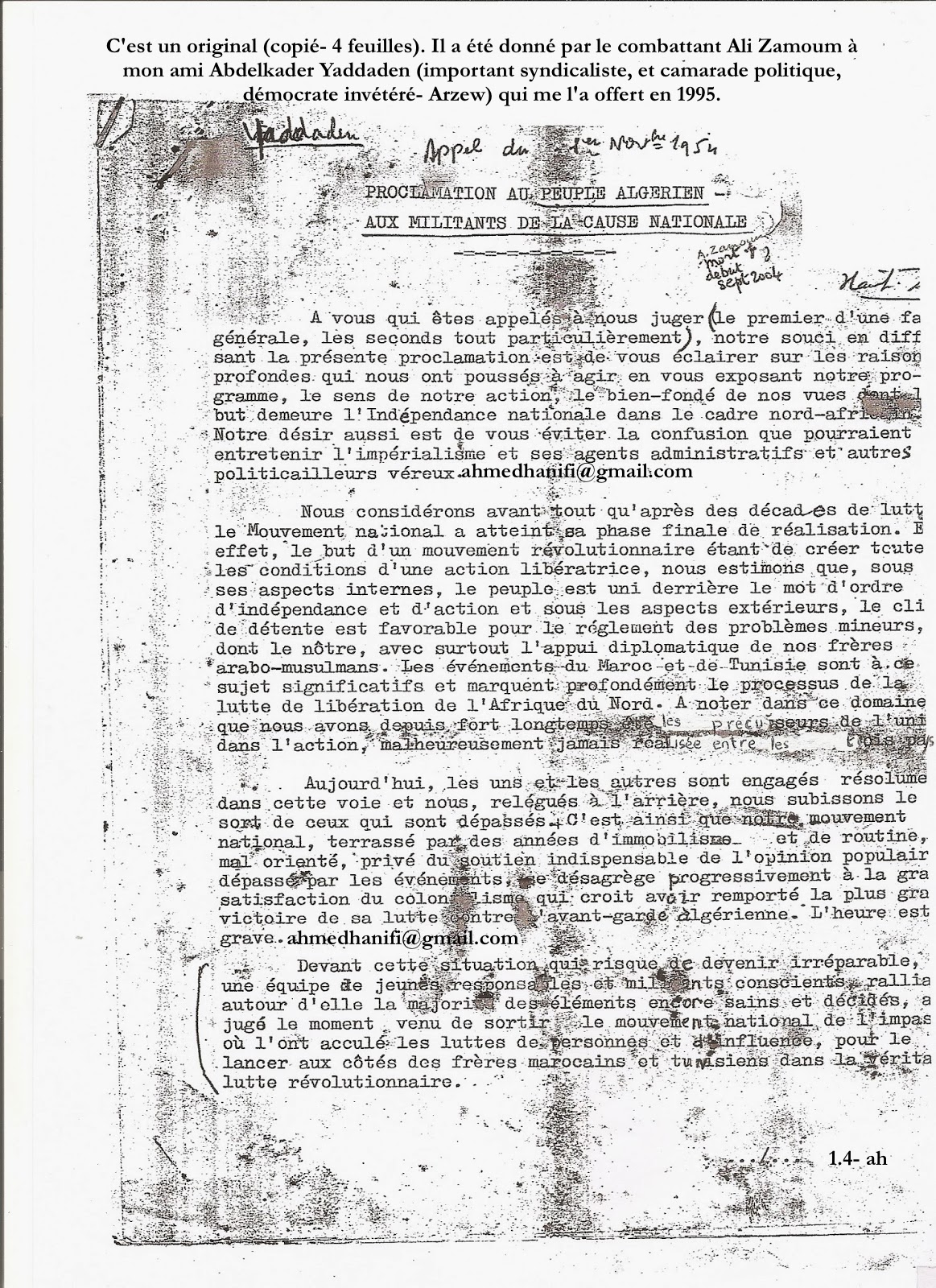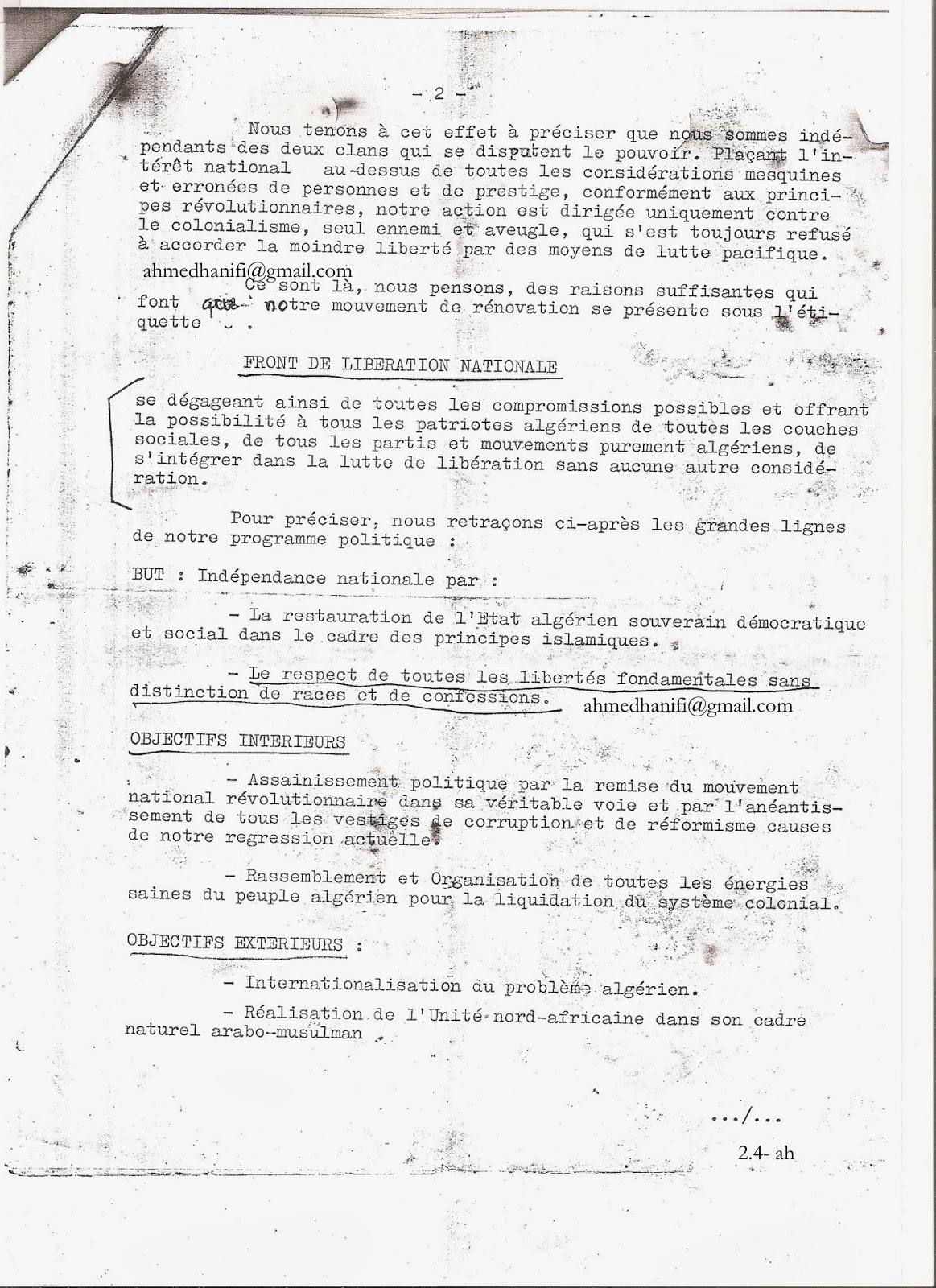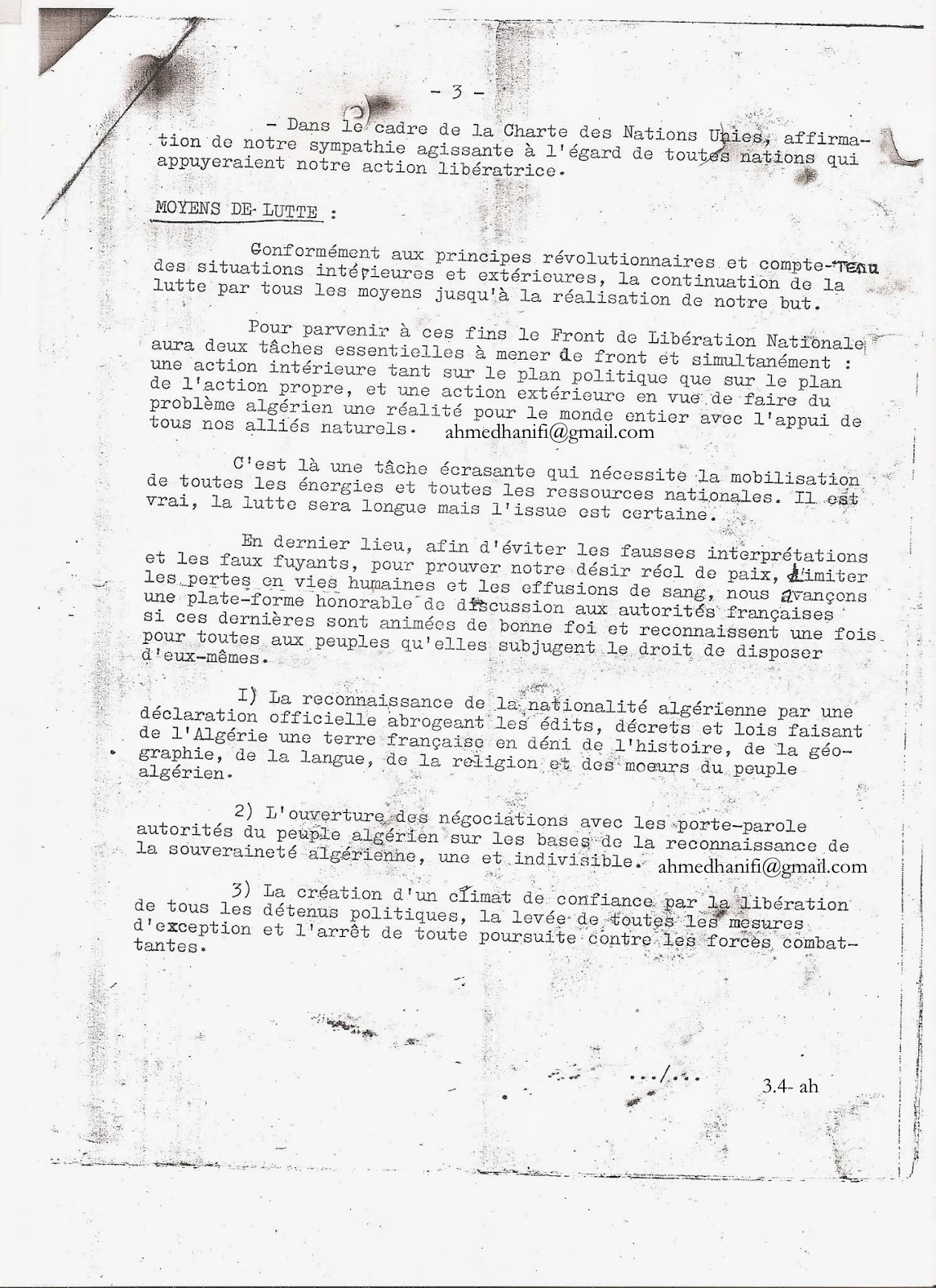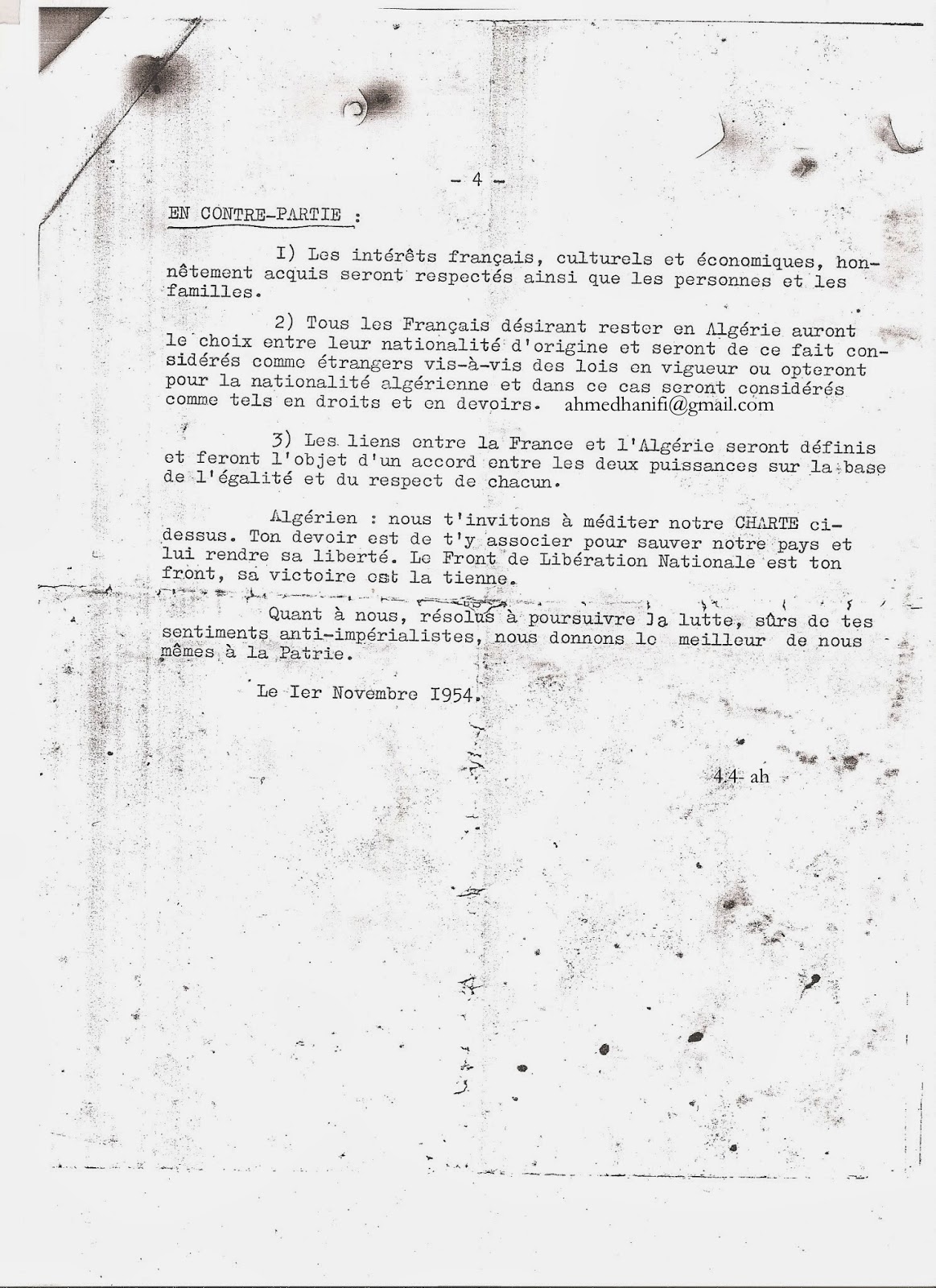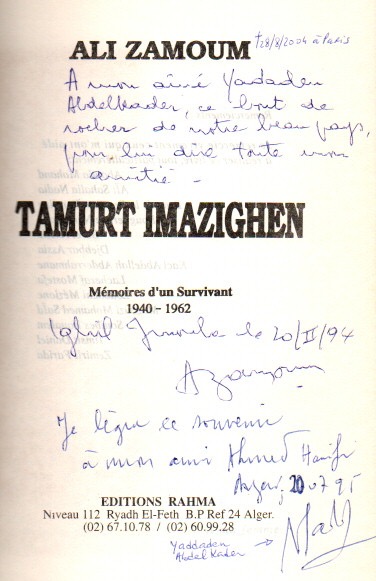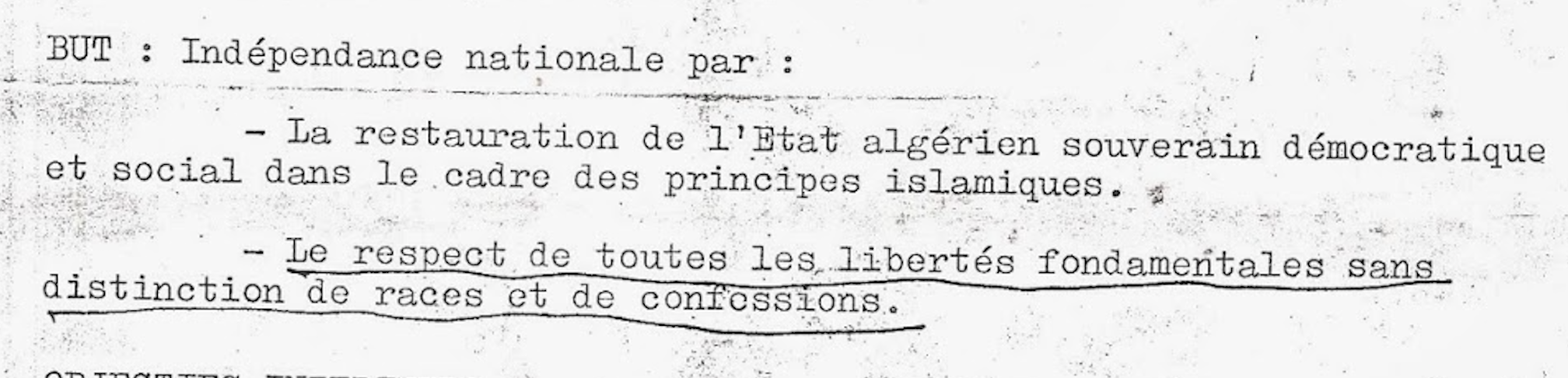Monique Hervo, une héroïne méconnue hélas, au cœur du bidonville de Nanterre pendant plusieurs années. Écoutez-la, elle raconte le bidonville, la terreur du funeste mardi.
Il y a 3 vidéos en une (1_Monique Hervo, 2_le bidonville de Nanterre (photos), et 3_ à propos de la photo ‘‘ici on noie les Algériens »
17 OCTOBRE 1961_ LE MASSACRE DE PAPON_ MONIQUE HERVO_ NANTERRE...
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
LE POADCAST
Podcast à propos du- poème de K. Yacine
-Le 17 octobre 1961, le FLN organise une manifestation pacifique pour protester contre le couvre-feu établi le 6 octobre par la préfecture de police de Paris et qui vise exclusivement les Algériens. Des milliers d’Algériens se dirigent vers les Grands Boulevards de la capitale. La répression organisée et ordonnée par Maurice Papon, alors préfet de police de Paris, se poursuit au-delà de la nuit du 17 octobre dans l’enceinte des centres d’internement et fait plusieurs centaines de blessés et de nombreux morts. On jette des morts et des blessés dans la Seine et les médecins légistes créent pour l’occasion une nouvelle terminologie : la « noyade par balles ».
Le nombre de morts reste à ce jour discuté et les évaluations ont oscillé, entre les décomptes minimaux des rapports officiels qui annoncent 3 morts au lendemain de la manifestation et les estimations des historiens qui font état de plus de 200 morts. Les historiens Jim House et Neil MacMaster soulignent qu’il s’agit dans toute l’histoire contemporaine de l’Europe occidentale de la répression d’Etat la plus violente et la plus meurtrière qu’ait jamais subie une manifestation pacifique.
Moins d’un an après les événements du 17 octobre 1961, Kateb Yacine publie un poème intitulé « Dans la gueule du loup ». Que nous apprend ce poème sur les événements mais aussi sur le travail de mémoire qu’il reste à faire en Algérie comme en France? Ce podcast explore la richesse évocatrice de ce poème.
Invités :
Lia Brozgal, Professor à UCLA et auteure de Absent the Archive. Cultural Traces of a Massacre in Paris. 17 October 1961, Liverpool University Press, 2020.
Bibliographie :
Didier Daeninckx et Mako, Octobre noir, Préface de Benjamin Stora, Ad Libris, 2011.
Jean-Luc Einaudi, La Bataille de Paris. 17 octobre 1961, Seuil, 1991.
Gilles Manceron « La triple occultation d’un massacre », in Marcel Péju et Paulette Péju, Le 17 octobre des Algériens, Editions La Découverte, 2011.
Musique :
Zik Zitoune, On a appris à nager (2017) (avec l’aimable autorisation des artistes)
Réalisation : Yassine Bouzar
___________________________________________________________
AH _ Jean-Luc EINAUDI face à Papon- 15 OCTOBRE 2021- In MEDIAPART
17 octobre 1961 : Einaudi face à Papon
- Par Histoire coloniale et postcoloniale
- BLOG : Le Blog de l’Histoire coloniale et postcoloniale
À l’occasion du 60e anniversaire du massacre du 17 octobre 1961, voici une archive filmique rare et précieuse : le début de la déposition de Jean-Luc Einaudi au procès de Maurice Papon, à la cour d’assises de Bordeaux, le 16 octobre 1997. Un moment décisif dans le retour dans la mémoire collective française de ce crime d’Etat. Par Fabrice Riceputi
À l’occasion du 60e anniversaire du massacre du 17 octobre 1961, nous présentons ici une archive filmique rare, précieuse : les 25 premières minutes de la déposition de Jean-Luc Einaudi (1951-2014) au procès de Maurice Papon à la cour d’assises de Bordeaux, le 16 octobre 1997.
On y voit et on y entend l’auteur de La bataille de Paris (1991), commencer le récit de cette journée d’horreur et de honte. Celui que l’historien Mohamed Harbi qualifia de « héros moral », assume l’écrasante responsabilité d’avoir à faire savoir devant la justice et l’opinion internationale ce que fut le 17 octobre 1961 et quel fut alors le rôle de Maurice Papon. A la demande de parties civiles : Michel Slitinsky et l’avocat Gérard Boulanger, ainsi que le MRAP et l’avocat Pierre Mairat. On ne pouvait pas selon eux, alors que seul son rôle durant l’Occupation était en cause dans ce procès, ne pas y exposer aussi « l’autre moitié » criminelle de Papon, bien qu’elle soit couverte par l’amnistie, et laisser dans l’ombre ses victimes algériennes. Et qui mieux qu’Einaudi pour exposer devant la cour des faits qu’il avait établis en enquêtant longuement ?
On comprend que Jean-Luc Einaudi, qui n’a alors jamais témoigné, en tant qu’éducateur à la PJJ, que devant des juges pour enfants, doive manifestement surmonter un certain vertige en s’exprimant à la barre. Et qu’il soupèse avec soin chacun de ses mots. La veille encore, l’accusé Papon a soutenu avec aplomb la version mensongère de 1961. Einaudi la ruine, à quelques mètres de ce dernier, dans une implacable leçon d’histoire. Il témoigne au total plus de deux heures et finit par ces mots :
Monsieur Papon voulait que la vérité ne puisse pas se faire. Finalement cette vérité a fait son chemin. Je suis venu ici en mémoire de ces victimes algériennes, enterrées comme des chiens dans la fosse commune réservée aux musulmans inconnus du cimetière de Thiais.
Cette déposition est un moment décisif dans l’histoire du retour dans la mémoire collective française d’un crime d’Etat longtemps occulté. Son impact judiciaire, médiatique et politique fut considérable. Elle désarçonna la défense de Papon et contribua à la condamnation de l’ancien préfet et ancien ministre à 10 ans de réclusion criminelle. Elle permit surtout une diffusion dans le grand public d’une connaissance de l’événement et du rôle de Papon. Elle obligea le pouvoir de l’époque à réagir et à annoncer une ouverture des archives. Celle-ci sera fort difficile à obtenir mais permettra, à l’aube des années 2000, d’importantes avancées historiographiques sur l’ensemble de la guerre d’Algérie.
La vidéo est suivie d’un extrait du livre de Fabrice Riceputi, Ici on noya les Algériens (Le Passager clandestin, 2021), qui expose le contexte et la portée de cette déposition.
La salle d’audience de la cour d’assises de la Gironde, spécialement aménagée pour l’occasion, est bondée. Sur l’estrade qui fait face au public, outre les quatre juges et les deux avocats généraux, se trouvent les dizaines d’avocats des parties civiles, ceux de la défense, les jurés. Sur la droite, dans un box, protégé du public par une vitre blindée et un garde du corps, l’accusé. À l’extérieur, dans une autre salle également remplie de journalistes français et étrangers qui n’ont pu trouver place dans le tribunal, on retransmet les débats sur grand écran. Les audiences, comme l’avaient été celles des procès Barbie et Touvier, sont intégralement filmées.
Derrière le président […], une grosse caméra noire a remplacé le buste de Marianne, ou l’allégorie de la Justice, qui, dans les salles d’assises, préside traditionnellement les débats. À Bordeaux les audiences quotidiennes seront toutes filmées et les cassettes rejoindront chaque soir les archives sous escorte policière (1).
C’est un procès dit « pour l’histoire », le procès le plus médiatisé depuis l’après-guerre. On juge l’ancien ministre du Budget Maurice Papon pour son concours actif dans la déportation entre 1942 et 1944, alors qu’il était secrétaire général à la préfecture de la Gironde, de 1 690 juifs, en huit convois, de Bordeaux à Drancy, dernière étape avant Auschwitz.
Mercredi 15 octobre
Un peu étrangement, avant d’évoquer Vichy, il faut parler de la guerre d’Algérie. Car l’accusé dont on examine aujourd’hui comme il se doit le curriculum vitae eut, dès son recyclage dans la préfectorale d’un État républicain restauré, une activité coloniale de premier plan. En 1945, après avoir été jugé bon pour le service par une commission d’épuration, il poursuivit en effet sa carrière à la sous-direction des affaires algériennes de l’Intérieur, puis fut, à deux reprises, de 1949 à 1951 et de 1956 à 1958, préfet de Constantine. Enfin, il dirigea la préfecture de police de Paris durant les dernières années de la guerre d’Algérie, de 1958 à 1962 (2). Il ne quitta ce poste qu’en 1967.
C’est à Maurice Papon lui-même que le président Jean-Louis Castagnède demande d’abord de raconter cette partie de sa carrière, ce qu’il fait bien volontiers. C’est un homme solidement préparé, sûr de lui et pugnace, nullement sur la défensive, qui prend la parole avec autorité. À quatre-vingt-sept ans, il n’a rien perdu de sa superbe :« Une voix sûre, qui prend son temps. Une expression aisée, qui sent le passé, un phrasé impeccable, conjugué au subjonctif et où il est question de carrière que l’on « embrasse », de sentiments qui « honorent » et de « charité parentale (3)».
À plusieurs reprises, le greffier de la cour d’assises indique dans les minutes du procès les postures théâtrales ainsi que les mouvements d’humeur d’un homme habitué au commandement et souffrant mal la contradiction. Les nombreux avocats des parties civiles le questionnent rudement, tentant de le déstabiliser. Il s’agace, mais a néanmoins réponse à tout. On aborde ses activités dans l’Est algérien, haut lieu de l’insurrection nationaliste. La terrible répression du soulèvement de Sétif en mai 1945, sur laquelle il fut d’abord chargé d’informer le ministre de l’Intérieur puis dont il dut gérer les suites en 1949 ? Elle « a, dit-il, soulevé [son] cœur et [son] esprit (4)». Plus tard, en poste comme préfet Igame (inspecteur général de l’administration en mission extraordinaire) dans un Constantinois où il avait tous les pouvoirs et que l’on nommait parfois «la Paponie», ne dirigea-t-il pas contre les civils algériens une répression des plus féroces, incluant, selon nombre de témoins, rafles, tortures, exécutions sommaires ? Ayant toujours « réprouvé la torture » et les exactions, la main sur le cœur, il écarte ces accusations qui le blessent. Devenu soudainement un brin orientaliste, il va même jusqu’à déclarer son amour pour un islam si « longtemps caressé » en Afrique du Nord, indiquant fièrement que « dans les wilayas musulmanes, […], on [l]’appelait alors “le Mâhadi” ». Ce qui signifie, poursuit-il doctement, « “le maître”, mais cela voulait dire le sage, le juste, et c’est peut-être la meilleure décoration que j’ai recueillie dans ma carrière ». Visiblement satisfait par l’effet de ce cliché du paternalisme colonial, l’accusé « éteint son micro d’un geste énergique » et se rassied, note le greffier (5).
On en vient à la préfecture de police de Paris, qu’il dirigeait lors de la manifestation des Algériens (6), le 17 octobre 1961. Papon ne redoute manifestement pas d’aborder ce sujet. Il connaît par cœur la partition de sa défense, pour l’avoir déjà jouée avec succès en 1961. Il y a là au contraire, selon lui, une excellente occasion de marquer des points décisifs pour la suite de ce procès. Elle lui permet en effet de rappeler à tous quel serviteur efficace et loyal de la république gaullienne il a été après Vichy. Et combien le général de Gaulle lui-même lui a manifesté sa confiance la plus entière, le couvrant d’éloges pour avoir « tenu Paris » face au FLN. Ce qu’il a fait, assure-t-il, sans violences excessives, même s’il convient que ses agents étaient alors rendus nerveux par les récents attentats du FLN contre la police parisienne. Il n’y eut pourtant, affirme-t-il comme en 1961, que deux morts parmi les Algériens, ce qui est trop, mais doit être replacé dans le contexte de la guerre sans merci livrée par le FLN jusque sur le territoire français. Pour lui, le vilain mot de « rafle » ne saurait être employé à propos des 11 700 manifestants « appréhendés » cette nuit-là selon ses services. Il les a tout simplement « mis à l’abri » des violences éventuelles. Enfin, ajoute-t-il, croit-on vraiment que de Gaulle l’aurait maintenu à son poste à Paris de 1958 à 1967, un record depuis Lépine, si les accusations délirantes de « massacre » lancées à l’époque par des irresponsables étaient fondées (7) ?
Parmi de nombreux autres témoins de moralité de haut rang, sa défense a d’ailleurs cité Pierre Messmer. L’ancien résistant et ministre des Armées de de Gaulle viendra en personne le lendemain matin confirmer sa version des faits et lui apporter une caution inattaquable. Michel Debré et Roger Frey, respectivement Premier ministre et ministre de l’Intérieur à l’époque des faits, étant morts, « reste à l’ancien préfet de police, qui a la malchance de vivre encore à quatre-vingt-sept ans, de répondre de la République et de la France », dit l’accusé, debout depuis trois quarts d’heure, la main tendue comme au Parlement. Et d’ajouter : « La France, tant que j’aurai un souffle, je n’y laisserai pas toucher (8) ».
Dans sa chronique quotidienne du procès, le journaliste Éric Conan souligne que l’effet produit par cette audience est « catastrophique (9) ». De fait, sorti inchangé de sa naphtaline et réaffirmé avec un culot hors du commun par Maurice Papon, confirmé avec autorité par des témoins au-dessus de tout soupçon, le mensonge d’État de 1961 peut toujours, trente-six ans plus tard, se faire passer pour la vérité.
Jeudi 16 octobre
Le lendemain, selon le même chroniqueur, est « l’envers de la journée précédente, du fait d’un seul témoin (10) » : Jean-Luc Einaudi, appelé à témoigner par certaines parties civiles. Comme il le confirme au président, ce témoin, né en 1951, n’a pas vécu la guerre d’Algérie à l’âge adulte. Il est, de son métier, éducateur et non historien, mais il a écrit un livre intitulé La bataille de Paris. 17 octobre 1961, publié six ans auparavant (11).
C’est à ce titre qu’il témoigne. Les parties civiles lui ont confié une lourde responsabilité, celle d’être leur seul « témoin d’immoralité » sur la période algérienne de Maurice Papon. Elles comptent sur lui pour démontrer une continuité criminelle et dissimulatrice entre son action sous Vichy et celle qu’il mena durant la guerre d’Algérie. Elles auraient pu choisir de concentrer l’attaque sur la torture et les exactions commises dans le Constantinois, alors que Papon y dirigeait les opérations d’écrasement du nationalisme, ou encore sur la tuerie du métro Charonne, le 8 février 1962, elle aussi commise sous ses ordres. Mais c’est principalement l’évocation de la répression du 17 octobre 1961 qu’elles ont retenue pour le confondre.
Exactement dix ans auparavant, Jean-Luc Einaudi commençait son enquête. Il collectait, en sillonnant l’Algérie, des témoignages sur le passage de Papon à Constantine et sur la répression du 17 octobre 1961. L’occasion qui se présente ici à lui de faire avancer la reconnaissance du drame dont il s’est fait l’historien, pour laquelle il milite, avec d’autres, depuis 1991, est proprement inespérée. Elle ne doit pas être manquée. Jusque-là, l’éducateur n’a jamais témoigné que devant des juges pour enfants. Et, même s’il s’est longuement préparé à cette épreuve avec l’avocat Pierre Mairat, un certain « vertige », dira-t-il, le saisit alors qu’il lui faut s’avancer à la barre de cette cour d’assises intimidante et s’exprimer, à deux pas de Maurice Papon lui-même, devant la presse nationale et internationale (12).
Autorisé à parler par le président, il se lance, carrure de rugbyman et regard doux, voix grave et débit lent, solidement agrippé à la barre. Et cet homme « habité » par les faits qu’il raconte, notent les journalistes, capte rapidement l’attention de la cour et du public pour ne plus la lâcher. « Le cauchemar des victimes, écrit Sud-Ouest, est encore le sien (13)». Il se livre à une véritable « leçon d’histoire », d’une longueur et d’une densité très rarement autorisées dans un tribunal. Pourtant, nul ne l’interrompt. Les CRS eux-mêmes, signale-t-on, ont abandonné leur poste de surveillance des abords de la salle pour venir « l’écouter avec attention » (14).
Ce que relate Einaudi, bien peu en ont alors connaissance. Et c’est effroyable. Il accumule sans aucune note les dates et les heures, les lieux du drame, le nom des victimes et des témoins, les descriptions circonstanciées des violences policières, les déclarations des protagonistes. Selon lui, la vérité est bien éloignée de la version donnée la veille par Papon. Ce qu’il démontre, c’est que, le 17 octobre 1961 et les jours suivants, en plein Paris, la police française commit, avec une violence inouïe, un véritable « massacre » de manifestants algériens entièrement pacifiques. Einaudi se livre, écrit Le Monde, à une « déposition-réquisitoire (15)». La démonstration est d’autant plus accablante qu’elle s’en tient soigneusement aux faits et évite tout excès de langage. C’est sous les ordres de Papon que ce massacre «au faciès » eut lieu, rappelle-t-il. Et ce dernier ne fit rien pour l’empêcher, ni pour l’interrompre. Davantage, Einaudi cite des mots adressés alors par le préfet de police à ses agents qui sonnent comme des encouragements à utiliser les moyens les plus violents, et même à tuer. Et des agents tuèrent en effet, détaille-t-il, au pont de Neuilly, au pont Saint-Michel, sur les Grands Boulevards, au Palais des sports de Versailles, au centre d’identification de Vincennes et dans bien d’autres lieux de la banlieue parisienne. Des jours durant, la Seine et les canaux charrièrent des cadavres d’Algériens morts par balle, par strangulation, par pendaison, par noyade ou des suites de matraquage à coups de crosse ou de bidule (16).
C’est le même Papon, ajoute-t-il enfin, qui inventa la version outrageusement mensongère, défendue bec et ongles par le gouvernement Debré, restée officielle jusqu’à ce jour de 1997, soutenue la veille encore devant cette cour, selon laquelle il n’y aurait eu que deux morts algériens. Einaudi, reprenant les conclusions de son livre, évalue quant à lui le nombre des victimes de la police à « un minimum de deux cents morts, vraisemblablement autour de trois cents ». Et il conclut ainsi :
Monsieur Papon voulait que la vérité ne puisse pas se faire. Finalement cette vérité a fait son chemin. Je suis venu ici en mémoire de ces victimes algériennes, enterrées comme des chiens dans la fosse commune réservée aux musulmans inconnus du cimetière de Thiais (17).
À quelques mètres de la barre où s’est tenu Einaudi durant deux heures trente, Maurice Papon, jusqu’alors plutôt serein, accuse le coup. « Rompant [avec] sa naturelle impassibilité, l’ancien préfet tapote nerveusement la tablette de sa main droite », écrit Le Monde (18).
.
Au président Castagnède qui lui demande s’il veut réagir à ce qu’il vient d’entendre, le prévenu ne trouve rien d’autre à dire que sa « stupéfaction ». Il renvoie une réponse à plus tard. Son avocat, Me Varaut, a réalisé que quelque chose d’inattendu et de fort préjudiciable aux intérêts de son client venait de survenir. Selon lui, c’est un « discours politique » qui a été tenu par Einaudi. Il dénonce une manœuvre traîtresse des parties civiles. Ces dernières viennent, dit-il, d’ouvrir « un procès dans le procès ». Il doit même avouer n’avoir pas « prévu l’importance » de cette évocation du 17 octobre (19). Commentant devant la cour cette prétendue négligence et révélant son trouble après la déposition d’Einaudi, Me Varaut a encore ces mots surprenants : « J’aurais dû le prévoir compte tenu que l’affaire de Charonne [sic] est une vieille obsession politique (20) ».
.
Cette confusion entre la répression du 17 octobre 1961, dont il vient pourtant d’entendre parler durant deux heures, et celle qu’il mentionne, le meurtre de neuf Français par la police lors d’une manifestation anti-OAS en février 1962, au métro Charonne, paraît aujourd’hui parfaitement incongrue dans la bouche d’un avocat posant volontiers en ténor du barreau. Mais elle est alors encore courante et fort symptomatique. Elle en dit long sur le sentiment d’impunité du notable de la Ve République. Le drame de Charonne a été abondamment commémoré par la gauche depuis 1962, au point d’incarner dans la mémoire collective, y compris dans celle de l’avocat royaliste de Papon, toutes les répressions liées à la guerre d’Algérie et opérées sur le territoire français (21).
Le 17 octobre 1961, quant à lui, a été longtemps « oublié ». Ce que ne réalisent manifestement pas encore Papon et son avocat, c’est qu’à compter de ce jour, c’en est bel et bien fini de cet oubli national sur lequel ils croyaient encore pouvoir compter. L’avocat ayant fait observer que son client est « très fatigué », l’audience est levée.
Pour la presse française et étrangère, qui s’ennuyait ferme depuis l’ouverture du procès six jours auparavant, un véritable événement vient d’avoir lieu : on a découvert d’autres cadavres dans les placards de Papon, des placards et des cadavres qui sont, cette fois, ceux de la République et non pas ceux de Vichy. Me Pierre Mairat raconte que, lorsque Jean-Luc Einaudi et lui-même sortent de la cour d’assises, ce 16 octobre 1997 en fin d’après-midi, une foule hérissée de micros et de caméras se rue vers eux et assaille de questions ce témoin qui vient d’accabler avec tant de force Maurice Papon et de mettre en lumière une tragédie « oubliée » (22). Einaudi, plusieurs jours durant, enchaîne les interviews. Le soir même, tous les médias évoquent, parfois longuement, le drame qui vient, contre toute attente, de ressurgir à Bordeaux. Au point d’obliger le gouvernement à s’exprimer, en la personne de deux de ses ministres. Il faut, disent-ils, « faire la lumière » sur cet événement. Par un heureux hasard de calendrier, le lendemain de cette audience est le trente-sixième anniversaire du 17 octobre 1961. Il est abondamment commémoré dans la presse française.
Il en ira désormais ainsi chaque année. Tous les 17 octobre, on montrera les terribles photos d’Algériens brutalisés ou tués prises par Élie Kagan et par Georges Azenstarck, ou des images du film de Jacques Panijel, longtemps interdit, tournées dans les bidonvilles de Nanterre (23). On publiera d’ahurissants témoignages de sauvagerie policière en plein Paris. Et l’on mentionnera, bien souvent aussi, le rôle joué par Jean-Luc Einaudi dans le retour mémoriel de l’événement.
Pour reprendre l’expression d’un auteur britannique, la République gaullienne, en commettant ce crime puis en le niant, avait fabriqué une « French memory’s bombe à retardement (24) ». Longtemps restée enfouie dans les tréfonds de la société française, cette bombe mémorielle explosa véritablement devant la cour d’assises de Bordeaux, trente-six ans plus tard. Ce 16 octobre 1997, une brèche s’est ouverte dans le mur de silence derrière lequel un consensus national avait si longtemps relégué le drame. Cette brèche ne s’est plus refermée. […]
Extrait de Fabrice Riceputi, Ici on noya les Algériens, La bataille de Jean-Luc Einaudi pour la reconnaissance du massacre policier et raciste du 17 octobre 1961. Préface de Gilles Manceron et précédé de « Une passion décoloniale » par Edwy Plenel. Paris, Le passager clandestin, 2021, pp 33-43.
1_ Éric Conan, Le procès Papon. Un journal d’audience, Paris, Gallimard, 1998, p. 27. Le film du procès, tourné en vertu de la loi Badinter de 1985, est conservé aux Archives nationales, sous la cote BB 30 AV Papon.
2_Éric Conan, Le procès Papon…, op. cit., p. 26.
3_ Le film documentaire Maurice Papon, itinéraire d’un homme d’ordre(2011), d’Emmanuel Hamon, résume bien cette carrière. On peut y voir quelques brèves séquences du procès de Bordeaux.
4_ Catherine Erhel, Mathieu Aucher et Renaud de La Baume (éd.), Le procès de Maurice Papon, vol. 1, 8 octobre 1997 – 8 janvier 1998, Paris, Albin Michel, coll. « Les grands procès contemporains », 1998, p. 194.
5_ Ibid., p. 192.
6_ La « manifestation des Algériens », expression consacrée, comprit aussi des Algériennes (de même que de très rares non-Algériens). Elle fut cependant majoritairement masculine, à l’image de la population algérienne immigrée en France à cette date. Le FLN organisa les jours suivants des protestations de femmes contre les violences.
7_ Ibid., p. 198-203.
8_ Pascale Nivelle, « Maurice Papon devant ses juges », Libération, 22 octobre 1997.
9_ Éric Conan, Le procès Papon…, op. cit., p. 27.
10_ Ibid., p. 28.
11_ Jean-Luc Einaudi, La bataille de Paris. 17 octobre 1961, Paris, Seuil, 1991.
12_ Jean-Yves Guéguen, Ces hommes qui viennent du social, Paris, Dunod, 2004, p. 56.
13_ Dominique Richard, « Une leçon d’histoire », Sud-Ouest, 16 octobre 1997.
14_ Éric Conan, Le procès Papon…, op. cit., p. 28.
15_ Jean-Michel Dumay, « Les heures noires de la France ressurgissent à Bordeaux », Le Monde, 17 octobre 1997.
16_ Le bidule qui équipe alors les forces de l’ordre est une matraque en bois, souvent d’acajou, longue de près d’un mètre.
17_ Catherine Erhel, Mathieu Aucher et Renaud de La Baume (éd.), Le procès de Maurice Papon, op. cit., p. 236.
18_ Jean-Michel Dumay, « Les heures noires de la France ressurgissent à Bordeaux», art. cit.
19_ Catherine Erhel, Mathieu Aucher et Renaud de La Baume (éd.), Le procès de Maurice Papon, op. cit., p. 240.
20_ Ibid.
21_ Voir surtout le livre magistral d’Alain Dewerpe, Charonne, 8 février 1962. Anthropologie historique d’un massacre d’État, Paris, Gallimard, coll. « Folio Histoire», 2006, p. 646-669.
22_ Entretien de l’auteur avec Pierre Mairat, 25 mai 2015.
23_ Octobre à Paris (1962), de Jacques Panijel.
24_ Cette formule, titre d’un article de Richard J. Golsan («Memory’s bombes à retardement. Maurice Papon, crimes against humanity and 17 october 1961 », Journal of European Studies, vol. 28, n° 109-110, 1998, p. 153-172), est citée dans Jim House et Neil MacMaster, Paris 1961. Les Algériens, la terreur d’État et la mémoire (Paris, Tallandier, 2008, réédité en poche en 2021), remarquable somme sur la répression de l’automne 1961 et son histoire mémorielle, abondamment utilisée pour écrire ce livre.
/////////////////////////////
Médiapart ? octobre 2021 
_________________________
LIBERATION 15 octobre 2021
par Thibaut SARDIER


___________________________________________________________
LIRE ABSOLUMENT (CLIQUER SUR CE LIEN):
https://www.histoire-immigration.fr/dossiers-thematiques/integration-et-xenophobie/histoire-et-memoires-du-17-octobre-1961
HISTOIRE ET MÉMOIRES DE LA MANIFESTATION DU 17 OCTOBRE 1961

________________________________________________________________________
LE POEME DE KATEB YACINE EN BD
Dans cet extrait d’octobre noir, BD coréalisée par Daeninckx et Mako (2011), le personnage reprend un poème de Yacine Kateb, la gueule du loup. Ce poème a également fait l’objet d’une adaptation musicale par le groupe les Têtes raides dans leur album Chamboultou en 1998. (in: lecafuron.fr/2015/10/)


________________________________________________________________________
EMISSION "C à VOUS" sur France 5 _ le 15 octobre 2021 avec Jean-François KAHN
________________________________________________________________________
_
Pour comprendre la férocité de la répression policière d’octobre 1961, il importe de se rappeler la conjoncture. Dès 1958, le FLN, qui menait en Algérie la bataille pour l’indépendance, avait importé la guerre dans la métropole et multiplié les attentats, d’abord contre l’appareil de production (ports, raffineries, etc.), puis contre les policiers.
Les attentats individuels, qui visaient indistinctement tous ceux qui portaient l’uniforme, connurent une flambée au printemps 1961, puis, après une trêve due aux négociations en cours à Évian et à Lugrin entre le gouvernement français et le FLN, à partir de la fin d’août 1961. Quarante-sept policiers tués dans le ressort de la préfecture de police (dont 15 supplétifs musulmans), 140 blessés, des attentats quasi quotidiens, une menace permanente : tel était alors le bilan de l’action du FLN.
En retour, les policiers survoltés développèrent un état d’esprit détestable. Ils avaient l’impression d’être mal aimés de l’opinion et reprochaient aux pouvoirs publics de ne pas punir assez vite ni de manière assez implacable les meurtriers de leurs camarades.
Gangrenés par le racisme et favorables à l’OAS, mouvement terroriste qui cherchait à conserver l’Algérie française, certains entreprirent de se faire justice eux-mêmes en déclenchant des opérations dites de « contre-terrorisme » au cours desquelles ils s’en prenaient aux premiers venus, du moment qu’ils étaient basanés. A cet égard, le couvre-feu institué par Maurice Papon le 5 octobre fut sans doute bénéfique à leurs victimes potentielles.
Ce couvre-feu avait pour but de priver d’oxygène l’organisation du FLN, qui, compte tenu des activités professionnelles des Algériens, fonctionnait essentiellement le soir et la nuit. Aussi, lorsque la Fédération de France du FLN décréta une manifestation de masse pour protester contre cette mesure, elle ne pouvait ignorer que la réaction des policiers serait d’une extrême violence.
Quel rôle exerça Maurice Papon dans la répression ? D’abord celui d’un haut fonctionnaire au service du gouvernement. C’est bien le sens de la déposition de Pierre Messmer, à l’époque des faits ministre des Armées, devant la cour de Bordeaux, en octobre 1997, au cours du procès de Maurice Papon : pour lui, ce dernier n’avait fait qu’exécuter les ordres du gouvernement.
S’il apparaît que le préfet de police n’a pas pris les devants d’une répression féroce ni excité ses troupes, qui n’en avaient nul besoin, sa responsabilité est cependant engagée sur plusieurs points. D’abord, par ses propos tenus aux obsèques de policiers abattus au début du mois d’octobre 1961 « Pour un coup reçu, nous en porterons dix ! », « Vous serez couverts », il absolvait par avance les exactions de la police. Même si l’on peut penser que son souci était avant tout de ne pas se couper d’une base dont la hiérarchie avait de plus en plus de mal à se faire obéir.
Ensuite, le « traitement de la manifestation », comme on dit en langage policier, met en lumière de graves dysfonctionnements. Du fait de l’incurie de ses services de renseignements, le préfet ne fut averti de la manifestation, semble-t-il, qu’au petit matin du 17 octobre, alors que, depuis plusieurs jours, l’organisation du FLN avait multiplié les réunions au sein de la communauté maghrébine et fait savoir que la participation de tous à la manifestation, hommes, femmes et enfants, était strictement obligatoire.
En conséquence, les forces de police mobilisées au soir du 17 octobre étaient extraordinairement faibles : 1 658 hommes, dont deux compagnies de CRS rappelées d’urgence de province, soit à peine plus que pour les journées de monômes du bac… Or on sait que les débordements policiers surviennent souvent dans un contexte de disproportion des forces en présence. Ainsi, au pont de Neuilly, pour barrer la route des Champs-Élysées à plusieurs milliers d’Algériens, le commissaire en place disposait en tout et pour tout de 65 hommes.
On peut mettre également en cause certains aspects du schéma de maintien de l’ordre. Celui-ci semble avoir privilégié l’arrestation des manifestants plutôt que leur dispersion. Sans doute était-il exclu de se contenter de disperser les milliers d’Algériens qui tentaient de se rassembler à l’Étoile, à la Concorde ou à l’Opéra : ils se fussent regroupés sans tarder. En revanche, il était possible de refouler les manifestants qui tentaient de franchir le pont de Neuilly en utilisant des grenades lacrymogènes, voire des grenades offensives (l’emploi de ces dernières en mai-juin 1968 devait provoquer seulement quelques blessés légers).
Au lieu de quoi, les manifestants furent toujours en contact direct avec des forces de police déchaînées. Partout, notamment sur les Grands Boulevards et sur la rive gauche, la violence policière fut extrême. Et non provoquée : il n’y eut pratiquement pas de blessés parmi les membres du service d’ordre. Les policiers frappaient sauvagement les Algériens, même quand ils gisaient, à terre, ensanglantés, et retardaient leur transport dans les hôpitaux. Quant à la hiérarchie, elle laissait faire ; on n’arrête pas un torrent.
Sur 20 000 à 30 000 manifestants, pas moins de 11 538 furent appréhendés pour être ensuite conduits au palais des Sports et au stade de Coubertin, où à leur arrivée des « comités d’accueil » les matraquaient de plus belle. On a parlé à juste titre d’une « nuit d’horreur et de honte » (Michel Winock).
La nuit, en l’occurrence, s’est singulièrement prolongée. Les registres d’entrée dans les hôpitaux montrent que de nombreux Nord-Africains blessés furent amenés aux services des urgences avec un retard allant jusqu’à plusieurs jours, et ce souvent pour des blessures de double origine, c’est-à-dire provoquées par deux séries de coups successifs : par exemple traumatisme crânien et contusions abdominales, fracture de côtes et contusions lombaires. Bien des victimes avaient été frappées de manière répétée, souvent dans les centres où elles avaient été regroupées.
Le comportement des fonctionnaires de police apparaît donc comme absolument indigne et Maurice Papon en est objectivement solidaire. Ce constat est aujourd’hui admis par la plupart des historiens, de même d’ailleurs que l’ordre de grandeur du nombre des morts. Ce dernier continue pourtant à faire l’objet d’une surévaluation à 200 ou 300 morts, dont Jean-Luc Einaudi s’est fait le héraut et qui est devenue dans certains médias la vulgate de la nuit du 17 octobre 1961(2).
Dans son dernier livre, cet auteur donne bien une liste de 325 noms de morts, mais elle couvre l’ensemble des mois de septembre et d’octobre 1961, et elle englobe une masse de morts qui ne peuvent être attribués à la police : des hommes du MNA, des anciens combattants de l’armée française, des Algériens dont les proches affirment qu’ils avaient refusé de payer l’« impôt », un harki, et jusqu’à deux proxénètes dont l’un fut tué par un rival à Pigalle…
Quant à nous, toutes les sources de police et de justice nous ont amené à une évaluation allant d’une trentaine de morts (la plus probable à nos yeux) à une cinquantaine. Nous avons longuement argumenté sur l’éventuelle sous-estimation du nombre des victimes et conclu qu’elle ne saurait bouleverser cet ordre de grandeur.
En tout état de cause, la violence de la répression policière ne saurait s’évaluer au nombre de morts et l’évaluation dont on a fait état est déjà considérable. C’est le bilan le plus tragique, à Paris, depuis la Commune de 1871.
1. Cf. Jean-Paul Brunet, Police contre FLN, le drame d’octobre 1961 Paris, Flammarion, 1999 ; Jean-Luc Einaudi, Octobre 1961 : un massacre à Paris Paris, Fayard, 2001. Cf. aussi Guy Pervillé, « 17 octobre 1961 : combien de victimes ? », L’Histoire n° 237, pp. 16-17.
2. Cf. M. Pons, « Nuit de cristal à la française », Le Monde diplomatique. Manières de voir n° 58, « Polémiques sur l’histoire coloniale », p. 16.
Jean-Paul Brunet , Les Collections de L’Histoire n° 15, mars 2002
__________________
Document 3. Un massacre longtemps occulté de la mémoire collective
5 octobre 1961 : Le préfet Maurice Papon décrète un couvre-feu réservé aux Algériens
17 octobre 1961 : Manifestation des Algériens organisé par le FLN pour dénoncer le couvre-feu. Le photographe indépendant Elie Kagan n’hésite pas à s’aventurer et photographier des dizaines de manifestants ensanglantés. Henri Georges , pour « Libération » couvre également l’évènement depuis l’arrière salle d’un café où affluaient des manifestants blessés.
octobre 1961 –mars 1962 : Jacques Panijel réalise « Octobre à Paris » dans la foulée de la manifestation. Le film est censuré jusqu’en 1973 et ne sort sur les écrans qu’en octobre 2011.
1961 – fin des années 1970 : Les autorités françaises font le silence sur cet évènement : censure de la presse, instructions judiciaires qui n’ont jamais abouti, décrets d’amnistie, difficulté d’accès aux archives, épuration d’un certain nombre de fonds.
1984 : Didier Daeninckx publie chez Gallimard « Meurtres pour mémoire »
1998 : les Têtes raides mettent en musique le poème de Kateb Yacine, « La gueule du Loup ».
2010 : Dans son film, « Hors La loi », Rachid Bouchareb évoque la manifestaion du 17 octobre 1961
Octobre 2011 : à l’occasion du cinquantième anniversaire de la manifestation du 17 octobre, l’Assemblée nationale accueille un colloque international consacré à l’évènement. De nombreux ouvrages sont publiés dont la BD octobre noir à laquelle à participer Didier Daeninckx.
17 octobre 2012 : Le président François Hollande déclare : « « Le 17 octobre 1961, des Algériens qui manifestaient pour le droit à l’indépendance ont été tués lors d’une sanglante répression. La République reconnaît avec lucidité ces faits. Cinquante et un ans après cette tragédie, je rends hommage à la mémoire des victimes. » Toutefois , on constate que rien n’est dit sur les auteurs de la répression , le déroulement de la manifestation et le nombre de victimes.
24 octobre 2012 : le Sénat vote une proposition de résolution devant aboutir à la reconnaissance officielle de la répression sanglante du 17 octobre 1961
Louis BRUN, novembre 2012
Document 4. Hollande reconnaît la répression du 17 octobre 1961, critiques à droite
(…) François Hollande, qui avait rendu hommage il y a un an aux victimes lors du cinquantième anniversaire de cette page noire de l’histoire française, a fait de cette reconnaissance une de ses promesses de campagnes. (…) Le président doit se rendre début décembre en voyage officiel en Algérie pour sceller de nouveaux rapports entre la France et son ancienne colonie.
Jeudi, Marine Le Pen, présidente du Front national, a lié la multiplication des actes de repentance publique avec l« hostilité » vis-à-vis de la France. « Vous n’avez pas le sentiment que toutes ces repentances ont une influence sur la manière dont un certain nombre de nouvelles générations de Français d’origine algérienne ont une hostilité maintenant à l’égard de la France, quasiment une haine, et même le sentiment que la France leur doit quelque chose qu’ils viennent d’ailleurs chercher, pour certains, de gré ou de force ?« , a-t-elle demandé.
Elle a attaqué François Hollande : « Ça doit être sa troisième repentance en cinq mois, il fait encore plus fort que Jacques Chirac. Faudrait peut-être qu’il regarde l’avenir« . « A quand la repentance pour la Saint-Barthélemy ? » a-t-elle interrogé. Mettant en doute la manière dont s’est déroulée la répression sanglante – un « événement éminemment contesté dans la réalité de ce qui est exprimé« –, Marine Le Pen a demandé une « réciprocité« de l’Algérie dans la reconnaissance de ses actes, parlant des « milliers de morts et de mutilations« à mettre au compte du FLN et le « pillage et destruction« des cimetières où étaient enterrés les pieds noirs.
Le communiqué de l’Elysée a aussi été vivement critiqué par le président du groupe UMP à l’Assemblée nationale, Christian Jacob. « S’il n’est pas question de nier les événements du 17 octobre 1961 et d’oublier les victimes, il est intolérable de mettre en cause la police républicaine et avec elle la République toute entière, écrit ce dernier. François Hollande doit rassembler et sa tentative de politiser les enjeux de mémoire d’une période difficile de notre histoire est dangereuse pour la cohésion nationale. »
Harlem Désir, futur patron du Parti socialiste, a « condamné avec la plus grande fermeté« les propos de Christian Jacob. « Par ses propos, M. Jacob se fait l’avocat indécent d’une répression qui a enfreint, ce soir du 17 octobre 1961, toutes les valeurs et toutes les règles fondamentales de la République« , estime-t-il. Or « depuis l’ouverture des archives officielles, les historiens ont établi l’ampleur de la répression meurtrière des manifestations pacifiques d’Algériens conduite sous les ordres du préfet Maurice Papon« , affirme-t-il. Selon M. Désir, « M. Jacob offre surtout au préfet Maurice Papon une terrifiante réhabilitation et se livre à une falsification insupportable de l’histoire« .
Une proposition de résolution sur la reconnaissance du massacre a été déposée par des sénateurs communistes au début de l’année. Elle sera examinée le 23 octobre. A l’Assemblée nationale, le député Front de gauche François Asensi a lui déposé mercredi une proposition de loi afin que toute la lumière soit faite sur ces événements.
Le député ex-PC de la Seine-Saint-Denis rappelle que depuis 1997, il demande l’ouverture des archives du ministère de l’intérieur « parce qu’une démocratie digne de ce nom ne peut maintenir le secret sur ces terribles événements« . « L’adoption de cette proposition de loi serait un geste de concorde à l’adresse du peuple algérien, ce peuple ami, et contribuerait au rapprochement entre nos deux peuples« , conclut François Asensi.
Le Monde, le 17 octobre 2012
_______________________
Dossier complet in: http://www.lecafuron.fr/2015/10/retour-sur-la-nuit-du-17-octobre-1961.html
________________________________________________________________________
LE BONDY BLOG

« Reconnaître le 17 octobre 1961 c’est reconnaître les autres combats contre un système d’impunité »
Par Amina Lahmar
Le 17/10/2021
Le massacre des Algériens le 17 octobre 1961 n'est toujours pas reconnu comme un crime d'État. Malgré les déclarations d'Emmanuel Macron, la France ne se considère toujours pas responsable d'une des pages les plus sombres de l'histoire coloniale. Fabrice Riceputi, historien, revient sur cette nuit sanglante et rappelle les enjeux d'une reconnaissance encore loin d'être gagnée. Entretien.
Le 17 octobre 1961, près de douze mille Algériens sont arrêtés, raflés et battus par la police de Maurice Papon, un an avant la fin de la guerre d’Algérie. Plus d’une centaine sont tués par balle ou noyés dans la Seine alors qu’ils manifestent pacifiquement dans les rues de Paris contre un couvre-feu nouvellement appliqué aux seuls Maghrébins. 60 ans plus tard, Emmanuel Macron, dénonce des « crimes inexcusables », pointe la « responsabilité » du préfet de Paris de l’époque Maurice Papon. Mais ne reconnaît toujours pas un crime d’État…
En quoi la (re)connaissance de ce crime d’État est-elle pourtant primordiale pour les familles et leurs descendants ainsi que pour le reste des Français, notamment issus de l’immigration post-coloniale ? L’historien Fabrice Riceputi, chercheur associé à l’Institut d’Histoire du Temps Présent et co-animateur du blog histoire-coloniale, fait paraître 60 ans après cette nuit, une nouvelle version de son ouvrage de 2015, “Ici on noya les Algériens, le combat de Jean-Luc Einaudi”.
Amina Lahmar : Pour quelles raisons les Algériens ont-ils marché pacifiquement le 17 octobre 1961 ?
Fabrice Riceputi : Ce soir-là, ils sortent dans les rues à l’appel de la Fédération de France du FLN [Front de libération nationale, NDLR] qui les enjoint à désobéir au couvre-feu décrété en Conseil des ministres, le 5 octobre 1961. C’est un appel à braver ce couvre-feu parce qu’il est totalement illégal, parce qu’on n’a pas le droit d’obliger seulement une catégorie de la population à rester chez elle la nuit.
C’est en ce sens une manifestation anti-raciste, contre une grave discrimination qui rend la vie des Algériens de région parisienne quasiment impossible.
C’est en ce sens une manifestation anti-raciste, contre une grave discrimination qui rend la vie des Algériens de région parisienne quasiment impossible. Donc c’est à la fois une manifestation anti-raciste, mais aussi anti-coloniale faite par des colonisés mais qui se passe en métropole à Paris, où ils se battent aussi pour l’égalité des droits. Leurs difficultés ne sont pas nouvelles, car cela fait des mois, voire des années que, depuis le début de la guerre de Libération, ils sont considérés collectivement comme des ennemis de l’intérieur. À cette époque, on a construit une image des Algériens à la fois faite de racisme biologique mais aussi d’islamophobie.
Le FLN, accusé de pratiquer le terrorisme, avait donné la consigne aux manifestants de ne pas porter, ne serait-ce qu’une aiguille ou un couteau.
On se les représente comme fanatiques, violents et dangereux. C’est un contexte très important qui explique beaucoup de choses. Mais ce qui est absolument confirmé par la recherche et par les historiens, c’est que cette manifestation était intégralement pacifiste. Le FLN, accusé de pratiquer le terrorisme, avait donné la consigne aux manifestants de ne pas porter, ne serait-ce qu’une aiguille ou un couteau sous peine de graves sanctions, privilégiant ainsi un mode de lutte collectif et pacifique.
A.L : Combien sont-ils ce jour-là dans les rues de Paris et combien dénombre-t-on de décès ?
F. R : Concernant les chiffres de participation, il y a peu de certitudes. La police dit immédiatement 20.000, mais à l’époque comme aujourd’hui, c’est selon la police. D’autres sources évoquent 40.000 ou 50.000 manifestants, mais le décompte est difficile, car les Algériens ne peuvent pas se rassembler tous ensemble et forment plusieurs cortèges à divers endroits de Paris. Disons qu’il y a eu une dizaine de milliers de participants, sachant qu’à l’époque en région parisienne, ils sont environ 150.000 immigrés, essentiellement des hommes à vivre dans des quartiers de relégation.
Dans toutes les répressions coloniales, comme on tue des gens dont la vie ne compte pas…
Ensuite, pendant très longtemps le débat a porté sur le bilan des victimes. Ils étaient entre trois (selon Maurice Papon) et trois cents (selon le FLN). En réalité, ce qu’il faut bien comprendre, c’est que dans toutes les répressions coloniales, comme on tue des gens dont la vie ne compte pas, on ne peut pas compter leurs morts avec précision.
A.L : Que se passe-t-il pour les 11 500 manifestants raflés que la police dit avoir « arrêtés » ?
F.R : Ils sont d’abord embarqués par des camions de la police et puis rapidement dans la soirée, on réquisitionne les bus de ce qui était l’équivalent de la RATP de l’époque. D’ailleurs, la dernière fois que ces bus avaient été utilisés, c’était en juillet 1942 pour rafler les Juifs. Des lieux de détention provisoire sont ensuite improvisés, notamment le Palais des Sports à la porte de Versailles, le stade Coubertin, mais aussi des commissariats et la préfecture de police.
On retient les noyés et les morts par balles évidemment, mais il y a eu un très grand nombre de blessés.
Ils vont être interrogés pour trouver les militants importants et détruire le FLN. Dans ces lieux, on enferme des gens qui arrivent souvent gravement blessés et ne sont pas soignés durant plusieurs jours, certains baignent dans leur sang. On retient les noyés et les morts par balles évidemment, mais il y a eu un très grand nombre de blessés.
A.L : Comment expliquer une telle répression de la part de la police, alors sous les ordres du Préfet Maurice Papon ?
F.R : Dès le matin du 17 octobre, environ 10.000 agents des forces de l’ordre – tous corps confondus – empêchent de groupes de manifestants d’entrer dans Paris. En fait, la consigne qui est appliquée par les policiers, c’est celle d’empêcher à tout prix ces gens de faire irruption dans les beaux quartiers de Paris.
On ne veut pas qu’ils s’approchent de l’Elysée et sur le plan symbolique, on leur dit de rester à leur place, dans les usines et les bidonvilles.
Sur le plan géographique, on ne veut pas qu’ils s’approchent de l’Elysée et sur le plan symbolique, on leur dit de rester à leur place, dans les usines et les bidonvilles. Et on sent bien, quand on lit les explications de Papon que ce qui est intolérable pour le pouvoir français à ce moment-là, c’est de voir cette immigration oser réclamer ses droits publiquement et de façon autonome.
A.L : Quelle sera la version de la Préfecture de police et plus largement de l’État à ce moment-là ?
F.R : Dès la nuit du 17 au 18 octobre, Maurice Papon fait un communiqué dans lequel il donne une version qu’il ne changera plus jamais. Selon cette version, il y a eu 3 morts, dont deux Algériens et un Français. Il affirme aussi que les Algériens ont été violents et qu’ils ont tiré sur la police.
Le Gouvernement arrive très facilement à imposer le silence.
C’est d’ailleurs cette fausse rumeur propagée sur les ondes des radios policières qui “enragera” les forces de l’ordre cette nuit-là. La presse relaie dans un premier temps la version policière avant de la remettre en cause. Mais le Gouvernement arrive très facilement à imposer le silence, il empêche par exemple la constitution d’une commission parlementaire, fait saisir des publications, et même un film sur le sujet.
A.L : Comparé au massacre du métro Charonne, l’événement du 17 octobre reste relativement méconnu du grand public, comment l’expliquez-vous ?
F.R : Effectivement, la gauche communiste française ayant appelé à la manifestation du 8 février 1962, elle se chargera d’organiser des obsèques absolument géantes, emmenant les morts de Charonne jusqu’au Père-Lachaise, avec des centaines de milliers de manifestants. Ce jour-là, seul un orateur fait allusion aux Algériens du 17 octobre qui, eux, n’ont pas eu d’obsèques.
On a l’intérêt et l’envie d’oublier cette sale guerre.
Certains ont été inhumés dans les bidonvilles, d’autres n’ont jamais été repêché et parmi ceux qui l’ont été, la plupart n’étaient plus identifiables. On a à faire à des gens dont la vie ne comptait pas ou comptait peu et donc il n’y a pas eu d’acte commémoratif fondateur. Cinq mois plus tard, c’est la fin de la guerre, les accords d’Evian puis en juillet l’indépendance et la France tourne la page sans la lire. On a l’intérêt et l’envie d’oublier cette sale guerre.
A.L : Vous racontez dans votre livre le combat de Jean-Luc Einaudi pour la reconnaissance de ce crime d’État. Quel a été le rôle de ce “simple citoyen qui s’est fait chercheur” dans la mise en lumière de la mémoire de la guerre d’Algérie ?
F.R : C’est dans les années 1990 que cette histoire ressort publiquement, grâce notamment au livre de Jean-Luc Einaudi, La Bataille de Paris qui est le premier contre-récit historique. Cet ouvrage ruine complètement la version de Maurice Papon, grâce à de très nombreux témoignages d’Algériens, mais aussi de policiers.
En 1997, quand Maurice Papon est inculpé pour complicité de crime contre l’humanité concernant sa participation à la déportation de centaines de Juifs vers Auchwitz, les parties civiles juives décident de demander à Jean-Luc Einaudi de venir témoigner à la barre, pour dresser un tableau de la personnalité et de l’histoire de l’ancien Préfet de police de Paris.
Sa déposition dure deux heures et fait état de tout ce que ses recherches ont permis d’établir. Le lendemain, toute la presse titre sur le massacre oublié d’octobre 1961. C’était un secret de Polichinelle, mais c’est vraiment à ce moment-là que la diffusion des connaissances de cet événement se fait dans le grand public.
A.L : Après la connaissance historique, le devoir de mémoire incombe aux dirigeants politiques. Qu’en est-il des gouvernements qui se sont succédés ces dernières années ?
F.R : Cette reconnaissance politique par les sommets de l’État est notamment portée par le collectif Au nom de la Mémoire, qui réclame que cet événement soit considéré comme un crime d’état, comme on a réclamé la reconnaissance de la responsabilité de la France dans la rafle du Vél’d’Hiv par exemple.
Lors du mandat de Sarkozy, il n’y avait rien à attendre, puisque c’est un nostalgique de la colonisation.
C’est un long combat, le seul résultat obtenu par le collectif, c’est en 2012, un communiqué de quelques lignes, arraché à François Hollande, qui dit tout ce qu’il peut dire pour gêner le moins possible. Cela est très insuffisant, donc la revendication continue à exister. Lors du mandat de Sarkozy, il n’y avait rien à attendre, puisque c’est un nostalgique de la colonisation. Enfin, Macron pour l’instant n’a fait qu’un tweet sur la question, pour ne dire quasiment rien.
Dans le rapport que Benjamin Stora a remis au président de la République en janvier 2021, il préconise un acte symbolique sur le 17 octobre 1961. Mais dans un contexte où le pouvoir stigmatise les recherches décoloniales en les traitant de séparatistes ou d’islamo-gauchiste, je doute fort qu’il fasse quelque chose qui indispose les syndicats de police.
Le 17 octobre 1961 a une actualité aujourd’hui qui est peut-être plus forte que jamais parce qu’on y parle de violences policières, de racisme systémique, d’impunité des crimes racistes.
A.L : Quels sont, selon vous, les enjeux de cette reconnaissance et en quoi est-elle importante dans le contexte actuel ?
F.R : Le 17 octobre 1961 a une actualité aujourd’hui qui est peut-être plus forte que jamais parce qu’on y parle de violences policières, de racisme systémique, d’impunité des crimes racistes. On a un gouvernement et une presse qui relaient la version policière mensongère, une hiérarchie policière qui couvre ses agents et une justice qui ne fait rien. Ce système-là, je n’ai pas besoin de vous expliquer qu’il s’est perpétué en France.
Alors bien sûr, les crimes sont moins nombreux qu’en octobre 1961, mais ce que réclamait la marche pour l’égalité et contre le racisme dans les année 1980, le Mouvement de l’immigration et des banlieues dans les années 1990, ce contre quoi protestaient les jeunes en 2005 lors des révoltes des quartiers populaires après la mort de Zyed et Bouna ou encore ce contre quoi se bat actuellement la génération Adama, c’est la fin de ce même système d’impunité. Or, ces mouvements ont été invisibilisés, occultés, souvent criminalisés, stigmatisés, mais n’en n’ont pas moins existé, à l’écart de la gauche officielle qui a très souvent regardé ailleurs et qui continue encore aujourd’hui.
Amina Lahmar
____________________________________________________________________________________
PHOTOS DE ÉLIE KAGAN
_____________________________________________________________________________________
------------- sur FB, dimanche 17 octobre 2021----------
________________
Manif Paris le 17.10.2021 _ Manceron et ?
________________________________________________________________________________
DANS LA GUEULE DU LOUP – KATEB YACINE
.
Poème chanté par « Les têtes raides »
Têtes raides mette en musique le poème de Kateb Yacine "Dans la gueule du loup"
Dans la gueule du loup
Peuple français, tu as tout vu
Oui, tout vu de tes propres yeux.
Tu as vu notre sang couler
Tu as vu la police
Assommer les manifestants
Et les jeter dans la Seine.
La Seine rougissante
N’a pas cessé les jours suivants
De vomir à la face
Du peuple de la Commune
Ces corps martyrisés
Qui rappelaient aux Parisiens
Leurs propres révolutions
Leur propre résistance.
Peuple français, tu as tout vu,
Oui, tout vu de tes propres yeux,
Et maintenant vas-tu parler ?
Et maintenant vas-tu te taire ?
______________________________________________________________________________
Photo Ahmed Tazir- Pont St Michel (FB 17102021)
_________________________________________________________________
1° de couverture- LE CHOC DES OMBRES_ 2017
____________
Le 17 octobre 1961, ‘raconté de l’intérieur’ dans mon roman « LE CHOC DES OMBRES ».
Extraits :
P 32 : « Recroquevillé dans une canalisation défectueuse, Kada grelotte dans son costume déchiqueté. Il tremble de froid, d’épuisement et de peur. De temps en temps il passe le bras sur son front pour éponger la sueur. Ainsi ramassé il s’aperçoit combien il est desservi par ce corps maigre et abîmé. Il lui faudra tenir dans cette position jusqu’aux premières lueurs du matin. Il s’applique à remuer le moins possible pour n’émettre aucun signe de présence. Il a soif et faim. Il a l’impression que son crâne est fendu. Il n’en revient pas d’être toujours en vie et de pouvoir appréhender le fil des événements de la veille, et plus encore ceux des jours et des mois passés. Il se tâte la cuisse lourde, l’épaule endolorie, la tête. Du sang séché colle à son cuir chevelu et à ses vêtements déchirés. Tous ses membres souffrent. À quarante ans, l’agilité qui était la sienne à vingt semble l’avoir abandonné. « Pourquoi ? » ne cesse-t-il de se questionner, même s’il sait qu’au cœur de la nuit la réponse ne lui sera pas offerte. « Pourquoi cette haine ? » Il a subitement honte. Il a une pensée pour sa mère, pour son père, pour sa famille, restés au bled. Pour son épouse. Une autre, épaisse, traverse son esprit comme un éclair : et si Messaoud et Hadj El-Khamis lui étaient arrachés ? Un sentiment de répulsion noue son cœur. Il s’en veut. De son poing serré, il martèle sa poitrine, puis sa tête. Il résiste aux larmes. « Pourquoi tant de haine ? »…
P 38 : … Lorsque son épouse le rejoignit au printemps 1953, Kada avait depuis peu quitté son cousin pour occuper cette misérable cabane des Pâquerettes. Depuis huit ou dix semaines. Pour se rendre quotidiennement à l’usine de pâtes, il avait acheté, dans le bidonville même, un vélo d’occasion Motoconfort, avec un porte-bagages et des sacoches comme neuves, en cuir. Il lui fallut près d’un mois d’entraînement laborieux, encouragé par Lahouari et des voisins du camp, avant de parcourir entièrement en pédalant, assis sur la selle, la distance qui séparait sa baraque de l’usine à pâtes. Khadra n’était guère désappointée, car elle n’attendait rien de son nouveau lieu de vie. Passées les premières semaines durant lesquelles elle ne cessait de pleurer, de se lamenter sur tout, elle était plutôt contente de se trouver auprès de son compagnon, et cela lui suffisait. Les mois qui défilaient l’installaient malgré tout dans une routine pétrie par la solitude — hormis son mari et de temps à autre une voisine de taudis, toujours la même, elle ne rencontrait personne — et la nostalgie de ses parents dans le souvenir des chaudes journées du bled. Certaines nuits de l’hiver suivant, la température atteignait quinze degrés au-dessous de zéro à la périphérie des baraquements et à l’intérieur même de certains bouges. L’appel de l’abbé Pierre émut la plupart des résidents du bidonville, qui, pour éviter que le pire n’advînt, dormaient tout habillés et laissaient les fourneaux fonctionner toute la nuit. Dans les rues de Paris et de sa banlieue, on mourait de froid et de misère. L’appel au secours des hommes de Dieu demeurait sans réel écho officiel. Le nouveau printemps était toutefois arrivé, chargé de mauvaises nouvelles du Tonkin. Les journaux titraient sur la défaite française face aux forces Vietminh : « ÀDien-Bien Phu, l’évacuation des blessés se poursuit. » Quelques mois plus tard, en août, alors que son épouse s’apprêtait à accoucher, Kada s’alarmait, car avec ces choses-là il ne savait comment s’y prendre. Heureusement, une jeune bénévole du Service civil international, très dévouée fit le nécessaire pour qu’une sage-femme dont elle était proche se déplace jusqu’à leur taudis. Kada l’appelle « Madame Monique ». C’est une jeune femme élégante, de taille moyenne, à peine plus âgée que la sienne, quatre ans de plus. Ses cheveux noirs sont coupés court. C’est une dame au cœur aussi grand que ses convictions, autrement dit aussi grand qu’on y logerait la générosité du monde. Depuis quelques années, elle s’était engagée dans les chantiers de volontariat international après avoir été scout de France. Elle qui vécut une partie de son enfance dans un hôtel meublé du 18e arrondissement de Paris sait ce que signifie l’habitat précaire. Depuis le grand incendie du carré nord du bidonville, « à côté de la gare de triage », la bénévole passait des nuits entières avec des familles en détresse. La sage-femme ne connaissait pas le bidonville et risquait de perdre beaucoup de temps, c’est pourquoi « Madame Monique » se rendit sur le lieu des rendez-vous, au 127 rue de la Garenne chez Ali le gérant du café-hôtel, à La Folie, pour attendre son amie. « Le 127 » est une adresse connue par tous les Algériens de Nanterre. La plupart d’entre eux l’utilisent. Moins pour l’hébergement — l’affichette scotchée sur la porte indique souvent « coumpli » — que pour siroter un café ou un thé avec les amis en écoutant M’hamed El Anka, Slimane Azem, Farid El Atrache, Lina l’Oranaise, ou Fadéla Dziria. C’est aussi leur adresse postale…
P 41 :… En juin 1956, peu avant la naissance de Hadj El-Khamis, leur deuxième enfant, Kada et son épouse emménagèrent dans une baraque du bidonville de La Folie, toujours à Nanterre, acquise au prix de deux mille nouveaux francs. Une somme importante qu’ils mirent plusieurs années à amasser. Comparé au premier taudis, le nouveau toit semble à Kada moins inacceptable. Il n’a bien évidemment ni eau, ni électricité, ni fenêtre, ni sanitaire. Le toit est constitué de toile goudronnée. À l’intérieur, des cartons sont cloués aux planches. Sur certains, on colle des photos de magazines, et on colmate les espaces avec du papier journal pour empêcher le froid de pénétrer. Il y a un coin cuisine avec un évier au-dessus duquel Kada accrocha un miroir de barbier avec un contour rouge plastifié. Des w.c. turcs furent aménagés près d’une décharge d’ordures, suffisamment éloignés des taudis pour ne pas suffoquer. Comme dans le bidonville des Pâquerettes, il n’y a qu’un seul point d’eau, une fontaine pour dix mille personnes, installée dans la rue de la Garenne. L’eau est transportée souvent dans des poussettes Terrot ou des voitures à pédales. Les enfants remplissent une ou deux bouteilles, parfois un seau. L’insalubrité et générale, mais l’insécurité est aggravée pour les Algériens par les effets de la guerre engagée contre la colonisation française. Effets qu’ils subissent quotidiennement. Les provocations sont permanentes. Elles émanent le plus fréquemment de la police qui s’installe devant les bidonvilles des jours durant. Les protestations de monsieur Raymond Barbet, le maire, restent sans conséquence. Des cellules discrètes du Front de libération nationale furent montées au sein même du bidonville. Pour les forces de l’ordre qui encouragent les « harkis de Paris » à dénoncer tout mouvement ou individu suspects, les Français musulmans sont musulmans étrangers plutôt que citoyens français. Pour éviter tout problème, les habitants du bidonville qui ne sont pas Algériens le font clairement savoir en peinturant en toutes lettres sur leur porte et en lettres majuscules « JE SUIS TUNISIEN » ou « ICI MAROUKEN », en choisissant des couleurs criardes. Ils ne sont pas nombreux. Les Portugais se comptent sur les vingt doigts et orteils. Eux aussi placardent leur origine — et un crucifix en bois le plus souvent — sur la porte d’entrée. Ils vivent à l’est de La Folie, après la zone des célibataires. Les Maghrébins se trouvent à l’Ouest vers la place El Qahira. On ne se mélange pas. Les contrôles policiers sont très nombreux, vexatoires et racistes. Les pleurs des mères et des enfants n’affectent guère les officiers très remontés. Ils extraient les hommes des taudis pour les entraîner brutalement, mains croisées sur la tête, jusqu’aux fourgons bleu sombre stationnés dans la rue. Parfois ils incitent leurs bergers allemands à sauter sur les moins dociles, ceux qui posent des questions, qui rouspètent. De temps à autre une baraque brûle et son occupant emmené menottes aux poignets vers une destination inconnue ou bien assassiné devant son gourbi sans que l’on sache si l’agression était une provocation des FPA, les Forces de police auxiliaire, des Calots bleus, ou bien un règlement de compte politique interne, car les Algériens sont partagés entre messalistes, ceux qui apportent leur soutien au Mouvement national algérien (MNA) de Messali Hadj, et frontistes, ceux qui l’offrent à El-djebha, le Front de libération nationale (FLN). Beaucoup d’Algériens paient de leur vie cette division. Lorsque El-djebha et l’Union des travailleurs algériens ordonnèrent la grève générale, Kada, qui est plutôt messaliste, ne sut pas trop comment il devait réagir. Et puis dans son travail, Mario le représentant de la CGT, auquel il fait grandement confiance, lui dit qu’il n’avait aucun conseil ni consigne à lui donner. Dans l’entourage de Kada on est plutôt FLN. Son cousin l’est, ses proches le sont. Kada se résolut alors à la discrétion. Mais lorsque ce parti lança il y a quelques jours l’appel à manifester le mardi 17 octobre pour dénoncer le couvre-feu discriminatoire instauré par Papon aux seuls « FMA », Français musulmans d’Algérie, et pour revendiquer l’autodétermination, il n’hésita pas longtemps. L’appel — « habillez-vous comme au jour de l’aïd » — fit le tour du bidonville et remplit les cœurs d’espoir. À la sortie du travail — il finit son service à 13 h — Kada se rendit directement aux Bains-douches, au 20 rue des Pâquerettes à deux cents mètres du camp. Il cadenassa son vélo à l’entrée. Il se lava dans la cabine N° 8 qu’il choisit chaque fois qu’il se rend dans ces douches. Si elle est occupée, il attend. Hier elle était libre. Il se rasa et rentra chez lui pour se changer. Exceptionnellement il s’habilla de son pantalon et veste de tergal noir et d’une chemise blanche, son unique costume qu’il réserve aux belles occasions. Puis il lissa ses cheveux avec de la brillantine, aspergea son visage et la chemise d’eau de Cologne. Lorsqu’il finit, il demanda à sa femme silencieuse dont il voyait bien les larmes couler sur ses joues de n’ouvrir à personne avant son retour. Puis il l’embrassa sur le front et lui dit « arrête, ça sert à rien ». Kada ne veut pas que Khadra manifeste. Une autre fois peut-être. Pourtant beaucoup d’hommes accompagnés de leurs enfants et épouse quittèrent le bidonville par petits groupes après avoir été fouillés par des responsables du Front. Aucun manifestant ne devait porter d’arme ou d’objet contondant. Ils sont tous convaincus que la cause qu’ils défendent est juste, qu’elle seule les extirpera de leur misérable condition. Lorsqu’il arriva à hauteur de l’entrée principale du bidonville, Kada se prépara à la fouille. Il leva les bras pour faciliter les palpations du frère de El-djebha. Seuls les hommes étaient palpés. Kada avait rendez-vous avec Lahouari au café-hôtel de la rue de la Garenne, mais il ne l’y trouva pas. C’est son adresse, celle du café de Ali, que beaucoup parmi les habitants de La Folie donnent pour toutes leurs correspondances, parfois même pour les rendez-vous. C’est chez Ali également que l’on dépose très discrètement les cotisations pour le FLN. Lors d’une ronda entre deux distributions de cartes ou d’une pioche pendant une partie de dominos, on adresse un signe à la personne chargée de la collecte et le tour est joué. À la fin de la partie, le militant attend le donateur derrière le comptoir, l’échange est voulu banal avec salamalecs et embrassades. Le client remet discrètement au militant une enveloppe (les billets sont toujours glissés dans une enveloppe qu’on cachette sans y porter d’inscription), on rajoute quelques mots et on se quitte jusqu’à la prochaine rencontre. Parfois c’est dans l’escalier interne qui mène à l’hôtel, ou dans une chambre que l’enveloppe passe d’une main à l’autre. Si la personne ne peut se présenter, c’est Ali qui a la charge de donner l’argent au collecteur en spécifiant le nom du bienfaiteur. C’est précisément à Ali que Kada remet plus ou moins régulièrement les 9500 anciens francs que ses parents récupèrent à Saint-Leu. Kada continue d’aider sa famille, même si c’est encore plus difficile qu’aux premières années. Lorsque Ali ou quelqu’un d’autre pose des questions, parfois délicates, concernant l’engagement politique de Kada, Lahouari remet aussitôt les choses dans l’ordre qu’il décida. Il protège en toutes circonstances son cousin. Ce mardi, Ali ferma plus tôt son café pour signifier aux habitués leur responsabilité. Mais lui-même ne se rendit pas à la manifestation, il resta pour avoir l’œil sur les va-et-vient dans son hôtel. « Wallah je ne l’ai pas vu » dit l’hôtelier à Kada qui alla alors se fondre parmi les milliers de manifestants partis à l’assaut des beaux quartiers de Paris. Kada trouve que même sous un temps maussade comme hier, sombre et pluvieux, ces quartiers sont magiques, comme sortis d’un rêve de vacances. Lorsqu’il s’y rend, à l’occasion de circonstances extraordinaires, il les traverse les yeux rivés au sol, car il ne veut déranger personne ni quoi que ce soit, « mais aujourd’hui c’est une autre histoire » pensa-t-il alors qu’il atteignait Neuilly. Il transita par le Rond-point de La Défense, un des lieux de rassemblement. Il continua sur l’interminable avenue de Neuilly avant de gagner la Seine et le pont qui porte le même nom. Ni la nuit qui s’installait, ni le froid qui se faisait plus vif, ni la pluie qui se remit à tomber, fine et perçante, ne découragèrent les manifestants qui arrivaient de toutes parts par flots ininterrompus : Puteaux, Courbevoie, Asnières, La Garenne... La masse des gens était devenue si dense que rares étaient les véhicules à moteur qui pouvaient circuler normalement. On n’entendait aucun slogan, juste le bruit des pas sur la chaussée mouillée, le clapotis de l’eau et les voitures au loin. C’est là, sur le pont de Neuilly, au-dessus de l’Île du Pont, que Kada reçut les premiers coups de bidules. Au loin on entendit des bruits secs, comme des coups assenés avec violence, suivis d’un mouvement de foule, des cris de femmes. Lorsque des fusillades retentirent, se sont ses enfants qui apparurent spontanément à Kada. Il prit peur et aussitôt se déprécia de se laisser gagner par cet état et les tremblements qui s’emparaient de ses jambes, mais c’était au-delà de ses forces. Il tenta de se ressaisir, fit demi-tour. La peur gagnait d’autres manifestants. Des enfants et des femmes couraient dans tous les sens et, de nouveau, Kada pensa à sa famille, à ses fils. Monique avait promis de passer à la maison, comme souvent les mardis, pour consacrer une heure de son temps — qu’il ne lui viendrait jamais à l’esprit de compter — au petit Messaoud pour qu’il apprenne à lire correctement et comprenne la leçon. Mais le matin il avait entendu dire que Monique avait la ferme intention de se joindre aux manifestants. Il la revoyait dans ses pensées. Il l’entendait : « Messaoud, retiens bien ceci, le mot qui dit ce que font les personnes, les animaux, ou les choses… » Kada ne savait plus, il ne retint pas la suite, « est un verbe, un verbe. » Il la voyait, penchée sur son enfant « lit Messaoud, lit : la fille rit. Le chat miaule. Le train roule. » Et Messaoud reprenait les phrases écrites sur son premier livre de grammaire française, à la lueur de la bougie, en faisant glisser son doigt le long des jambages et traverses des lettres, et il répétait encore à la demande de Monique : « la fille rit... » Kada sourit à cette pensée. Comment son fils, qui n’a que sept ans, pouvait saisir ce que lui-même ne comprend pas ? Des policiers, groupés, chargèrent de plus belle : « ratons ! », « fellouzes ! », « crouillats ! » La présence des Français musulmans d’Algérie dans les rues est perçue comme un défi, comme la violation du couvre-feu instauré pour eux seuls, dès 20 h 30. Des Forces de police auxiliaire sautèrent des cars Renault noirs qui venaient des rues adjacentes et se mirent à frapper au hasard avec leurs armes. L’un d’eux se rua sur Kada qui avançait le long des immeubles, tête basse. Plongé dans ses pensées il ne comprit pas de suite ce qui lui arrivait. Il projeta ses bras devant lui pour protéger son visage, son corps. L’agent de police redoubla de férocité. Il lui assena de violents coups avec la crosse de son arme qui causèrent de nombreux hématomes et fendirent son arcade sourcilière. Le policier hurlait, ahanait entre deux injures « pourri, fellaga ! » Dans sa tentative de se dégager de l’emprise de cette force tombée sur lui qu’il ne voyait pas, Kada ne réalisait pas qu’il avait affaire à un agent de l’ordre public. Il était submergé par une force physique, un rocher, un camion, un monstre. Il revit madame Hervo, son fils Messaoud, sa mère. Puis il bascula. Il tomba à terre, face contre le trottoir ruisselant d’eau boueuse. Il demeura ainsi, immobile, pendant un temps dont il ne sait s’il dura dix minutes ou soixante, avant de se relever, aidé par des manifestants. Les FPA avaient, lui dit-on, embarqué dans leur fourgon plusieurs marcheurs. Kada entendait comme des échos au loin, un brouhaha. Il devinait les slogans : « les racistes au poteau, l’Algérie algérienne ! » Celui-ci avait fait plusieurs fois le tour du bidonville. L’homme qui le soutenait par la main lui demanda de relever la tête « Rfâ rassek ya si Mohamed ». Au ton sec de sa voix, Kada supposa que l’homme appartenait au service d’ordre ou d’encadrement. Il le remercia du regard. Ses lèvres tremblaient comme ses paupières. Puis il reprit la marche, incertaine, sur une centaine de mètres. Les tiraillements de son cuir chevelu l’obligèrent à des grimaces qui déformaient son visage. Kada décida d’abandonner. Il s’éloigna des marcheurs malgré la garde des membres du FLN. L’homme qui aida Kada poursuivit son travail, loin de lui. Mais la surveillance devenait moins sévère, du fait de la nuit. Kada entama une marche à travers d’autres rues moins chargées, une marche à contresens des manifestants. Il atteignit La Folie en rasant les murs, trempé, flageolant sur ses jambes, la honte au cœur et la peur au ventre d’être découvert ou d’être tué. La semaine précédente, à Gennevilliers, un jeune Algérien qui sortait d’un cours du soir de rattrapage, fut froidement abattu. Un autre, âgé de 13 ans, fut tué par une rafale tirée par des policiers à Boulogne-Billancourt, rue Heinrich. Depuis le début du mois, il ne se passe pas un jour sans que l’on apprenne l’assassinat ou le meurtre d’un homme, parce qu’il est Algérien ou apparaissant comme tel. Un Portugais et un Sicilien basanés furent ainsi tués durant ce mois d’octobre. Un journal titra : « Événements d’Algérie : deux Européens victimes d’une bévue policière à Paris. »
Dans le tuyau asséché, Kada se remet peu à peu. « Pourquoi cette haine ? » se demande-t-il. Il tente de se redresser, mais la canalisation dans laquelle il se terre est trop étroite, même pour lui. Ses bras, ses jambes, sont endoloris. Il ne s’en veut pas d’avoir fait le choix de la manifestation contre les autorités, mais il ne s’attendait pas à une telle fureur. Mourir pour avoir marché avec les frères ! Tôt le matin, il abandonne discrètement sa cache. Il est transi de froid. Il a faim et soif. Avant que l’animation plus ou moins habituelle ne gagne de nouveau le bidonville, Kada atteint sa baraque, de l’autre côté. Lorsqu’il ouvre la porte, il comprend à la vue de ses yeux rougis que Khadra ne dormit pas de la nuit et qu’elle pleura toutes les larmes de son corps. Elle ne se risque pas à flageller ses cuisses comme elle est tentée de faire et comme il est de coutume de procéder dans de telles situations, et la situation en l’occurrence se manifeste en cet homme devant elle, hagard, au front marqué par des plaies, le corps recouvert de lambeaux dégouttant d’eau sale, un homme qu’elle reconnaît à peine. Mais c’est la guerre et Kada la prie de se calmer, de reprendre ses esprits « ma ândi walou, ma ândi walou », je n’ai rien répète-t-il. Khadra, nerveuse, va chercher du bois pour lui faire chauffer de l’eau, en gémissant, la main sur la bouche. Les enfants dorment.
Ce mercredi, un autre silence plus grand et plus lourd, semblable à ceux de trois cimetières réunis, plane sur le bidonville. Dans un murmure partagé, des hommes de bonne volonté soulagent les blessés qui se comptent par centaines et qui ne veulent surtout pas se rendre à l’hôpital. Ils prendraient le risque d’être arrêtés et torturés. Il faut à Kada trouver des arguments suffisamment solides pour justifier son absence et son état physique auprès du chef d’équipe. Il soupire à la pensée qu’il aura le soutien de Mario, même si son chef n’est pas dupe.
Alors que Le Populaire de Paris compare la vie des Algériens à celle des prolétaires du siècle passé, l’Express fait un long compte-rendu de son correspondant « chez les melons, les crouillats, les bicots… » et titre en une sur le visage d’un fils de ceux-là : « Jean Cau chez les ratons ». Pour 1,25 NF. »
______________________________________
Évidemment, mon texte est une fiction.
In : LE CHOC DES OMBRES _ Ahmed HANIFI
Achevé d’imprimer en octobre 2017
ISBN : 979-10-96238-07-1
Dépôt légal : octobre 2017
Imprimé en France
Éditions Incipit en W
___________________________________
CLIQUER sur ce lien pour lire le roman
https://ahmedhanifi.com/le-choc-des-ombres/
___________________________________________
______________________________________
De Fabrice Riceputi, le 17 octobre 2021
_________________________________________
LE CANARD ENCHAINÉ _ MERCREDI 20 OCTOBRE 2021
_______________________________________