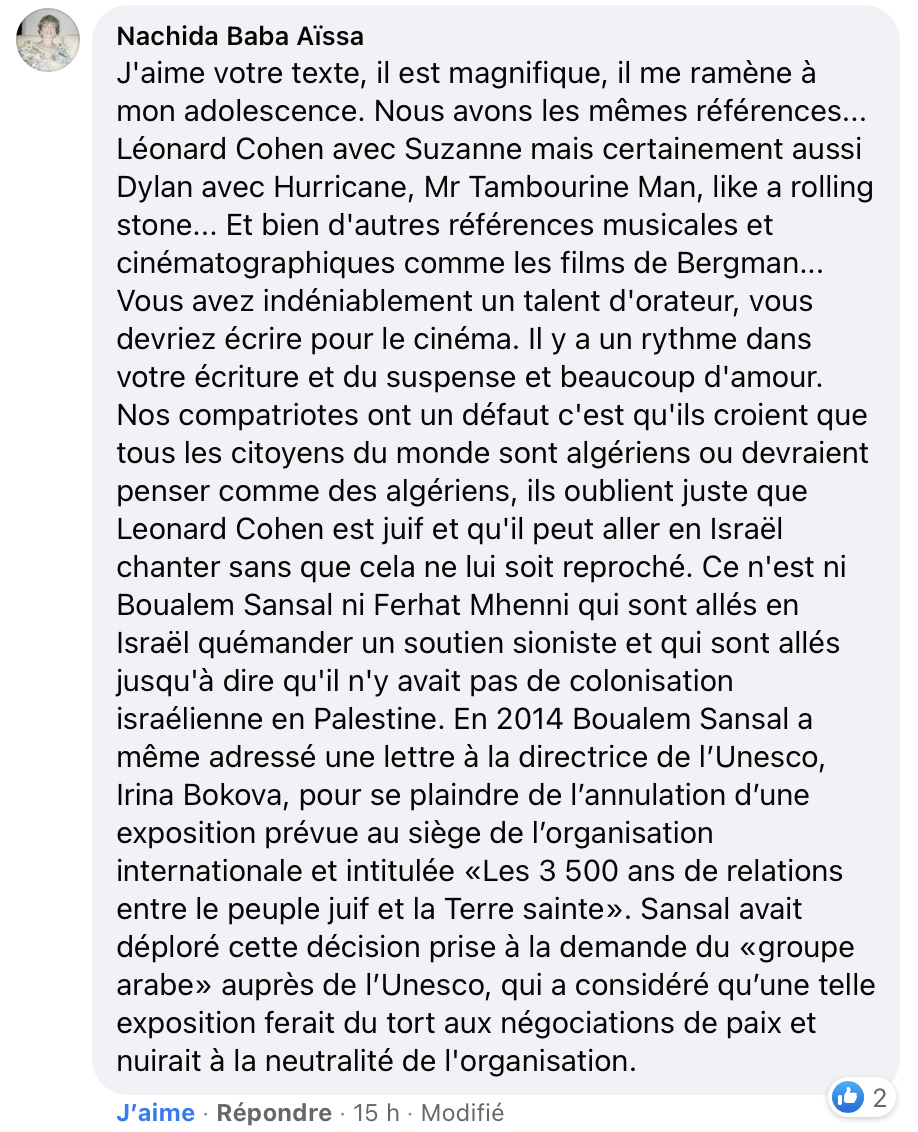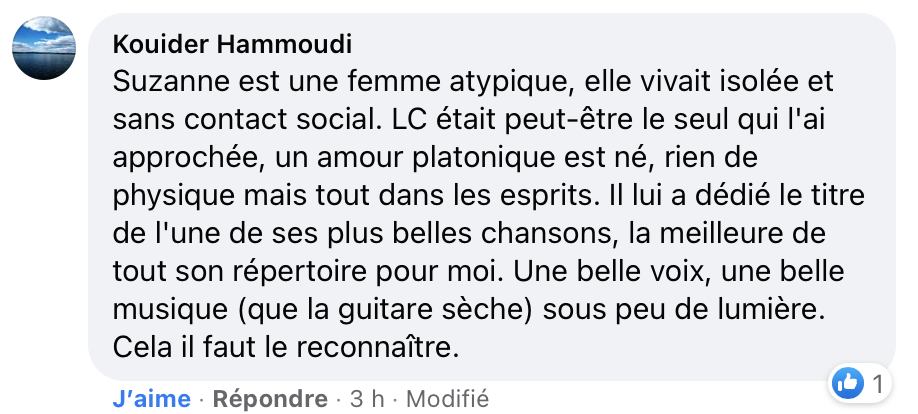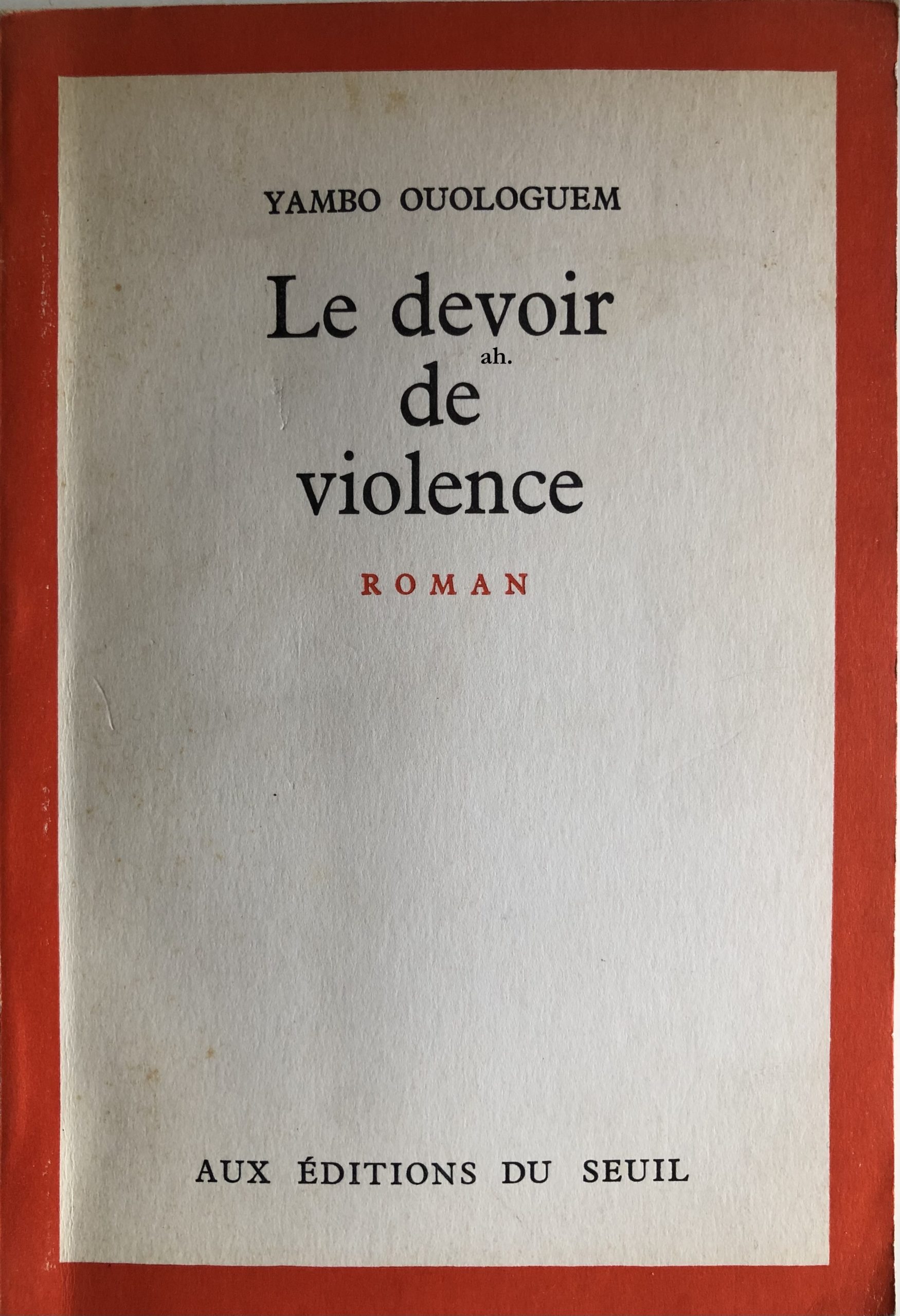Il y a cinq ans disparaissait LEONARD COHEN
Suzanne, par Léonard Cohen
Pour ne pas oublier Léonard et Suzanne
C’était en 1973. J’avais l’âge de toutes les folies et même deux ans de plus. Et le diable au corps. Je me trouvais dans un pays lointain, aujourd’hui à deux clics de souris, à deux doigts donc. Mais à l’époque, ce pays qui nous faisait rêver était pour nous le bout du monde. Par ce « nous » j’entends la bande Snouci and C° du quartier Michelet d’Oran – bande à laquelle s’est jointe Suzanne L. fraîche émoulue de La Sorbonne, enseignante à la fac de Lettres d’Oran Sénia. Dès qu’arrivait le vendredi, veille de week-end, nous délaissions la brasserie Le Majestic, notre quartier général, pour aller fureter les quartiers autour de la place des victoires, du marché, de la cinémathèque. Mais LGF, « el-khawa » nous empêchaient de tourner en rond. Treillis verts et triques noires, non merci. Où que nous allions, ils exigeaient de nous qu’on écrase l’Afras ou la Marlboro et qu’on leur montrât le livret de famille, ou de rentrer à la maison. Le temps était venu pour notre groupe, la bande Snouci and C°, d’aller voir ailleurs. Au début des années soixante-dix, notre plus bel ailleurs, à l’unanimité, était la Suède. Chacun a fait comme il a pu pour quitter (déjà !) notre pays d’enfer (le terme est ici très négatif). Il nous fallait bouger.En 1973, je me trouvais donc en Suède et plus exactement à Farsta dans un grand appartement de son centre. Farsta est un joli bourg dans le sud de Stockholm. J’étais à moitié allongé sur un sofa. J’étais plus ou moins allongé avec dans la main une cannette de je ne sais plus trop quoi. Il me reste dans mes souvenirs que le jus était sacrément énergisant. Dans la pile de vinyles j’avais choisi « Suzanne » un morceau très en vogue, « Suzanne takes you down to her place near the river/ You can hear the boats go by/ You can spend the night beside her/ And you know that she’s half crazy… » Dans le spacieux appartement vivait une demi-douzaine de personnes, toutes – je le découvrirais – aussi sympathiques et farfelues que déglinguées. C’était Suzana, une fille que j’avais connue dans une auberge de jeunesse « L’auberge du quai de Jemmapes » à Paris qui m’y avait invité. Nous avions fait le trajet ensemble en stop de la Porte de Clichy jusqu’à la banlieue de Stockholm grâce à un routier sympa de Max Meynier (vous ne connaissez pas Max ? un jour je vous raconterai). Trois jours de route. Ce jour à Farsta était un samedi, je m’en souviens bien, Suzana m’avait proposé d’aller voir ensemble Viskningar och rop de Bergman, à son retour. Elle était partie voir sa mère je ne sais plus où. Les autres co-locataires étaient eux aussi absents. J’étais seul, allongé sur un sofa blanc, une canette à la main, captivé par Suzanne de Cohen. « But that’s why you want to be there/ And she feeds you tea and oranges/ That come all the way from China/ And just when you mean to tell her/ That you have no love to give her » Les Suzanne m’envoutaient. De sa voix profonde Cohen nous embarquait auprès de lui, il nous invitait aux voyages les yeux fermés en toute confiance. J’étais plus ou moins allongé en sirotant mon jus de je ne sais plus quoi, lorsque j’entendis le bruit d’une clé dans la serrure de l’appartement suivi par le grincement de la porte. Le temps de me retourner, un mec était planté là, courbé, un pack de Carlsberg V dans les bras. Il a dit quelques mots en suédois. J’ai compris « vän » (ami). Son allure générale n’inclinait guère à la bienveillance. Manifestement il semblait bien éméché. Et même plus qu’éméché. Je me suis levé comme un soldat prêt à se mettre au garde-à-vous. Que faire d’autre lorsqu’à vingt ans on se trouve dans de tels draps ? « Hi » j’ai dit en tendant la main, peu rassuré. Le gars m’a regardé un moment. N’a pas répondu à la main tendue. Il s’est affalé dans un fauteuil, puis a posé sans délicatesse le pack de bière sur la table basse à côté. « U come here with Suzana, is n’t man ? » Et l’autre là-bas qui sillonnait sur le tourne-disque, se fichant de la situation. Il chantait encore « Then she gets you on her wavelength/ And she lets the river answer/ That you’ve always been her lover ». J’ai dit « Suzana, heu, yes, yes… » Je ne savais quoi dire en fait, car le type ne m’inspirait pas confiance. Le visage déformé il a baragouiné je ne sais quoi d’autre, a porté son bras droit dans la poche arrière de son pantalon pour en extraire un objet noir qu’il a tendu vers moi. « Cohen se fiche de moi » ai-je pensé. Il n’arrêtait pas. « And she shows you where to look/ Among the garbage and the flowers/ There are heroes in the seaweed/ There are children in the morning/ They are leaning out for love/ And they will lean that way forever/ While Suzanne holds the mirror ». Le voyou cracha « This is for you guy ». Le « this » signifiait l’objet qu’il tenait fermement dans la main. Et il disait qu’il me le destinait. Je n’avais pas trop vite saisi. Était-ce une plaisanterie ? Le gars ne souriait pas. Son regard, sa bouche, son visage, exprimaient plutôt de la colère. Je compris au terme d’un moment qui me parut une éternité que décidément non, le malfrat ne rigolait vraiment pas. Mais alors pas du tout. J’ai tenté d’entamer une discussion avec lui. Sur le bout des doigts ou des pieds. Plutôt des pieds. Le type était occupé à dégoupiller une Carlsberg, il cherchait dans sa poche avec sa main libre un instrument pour. L’autre main tenait fermement un révolver. Le moment était propice si je voulais connaître la suite du temps qui passe. En une fraction de seconde, de celles qui nous motorisent, qui nous galvanisent lorsque nous nous trouvons dans d’identiques situations, j’ai réussi à m’extraire de la nasse qu’était devenu l’appartement. J’ai dévalé je ne sais comment les trois étages de l’immeuble, traversé la cour, suis sorti dans l’avenue, ai couru, couru, couru, sans me retourner jusque dans Djurgarden, un grand parc où se promenaient des centaines de personnes au sein desquelles je me suis fondu. « Peut-être pas des centaines » ai-je penssé, mais enfin, ce n’était pas l’heure de ronchonner. Il faisait lourd, il faisait beau, je ne sais plus. Ces petits détails n’ont pas marqué mon esprit. J’entendais au loin Suzanne, « And you want to travel with her/ And you want to travel blind/ And you know that you can trust her/ For she’s touched your perfect body with her mind. » Je ne voulais rien d’autre que « voyager avec elle… voyager les yeux fermés » Je savais que je pouvais lui faire confiance… »Le soir, lorsque la nuit se fut bien installée, Suzana me raconta l’histoire de ce type « il est un peu dérangé, il n’est pas méchant, non, il dit toujours qu’il va tuer quelqu’un. He always says that ! ». C’était en 1973. J’avais l’âge de toutes les folies et même plus.Aujourd’hui, lorsque j’écoute cette chanson, je retrouve mes vingt ans. Finalement le temps, est d’une certaine manière, défait.Leonard Cohen est mort, mais pas Suzanne. Aucune des trois. La suédoise est grand-mère, l’égérie d’Oran a retrouvé Paris et Suzanne l’éternelle est en nous tous. Elles sont toutes plus vivantes que jamais. Je les entends encore, près de cinquante ans plus tard, les cheveux blanchis, me fredonner notre air préféré, « And you want to travel with her/ And you want to travel blind … »
Ahmed Hanifi, Marseille le 6 novembre 2021
Ce texte (modifié) a été initialement écrit le 12 novembre 2016
Léonard Cohen est mort le 7 novembre 2016 à Los Angeles à l’âge de 82 ans
(lire également ici sur ce même blog:
http://leblogdeahmedhanifi.blogspot.com/2020/02/683-la-2-mort-de-suzanne.html
http://leblogdeahmedhanifi.blogspot.com/2016/11/558-adieu-suzanne.html
_____________________________
Sur Facebook, il y eut des réactions au texte…

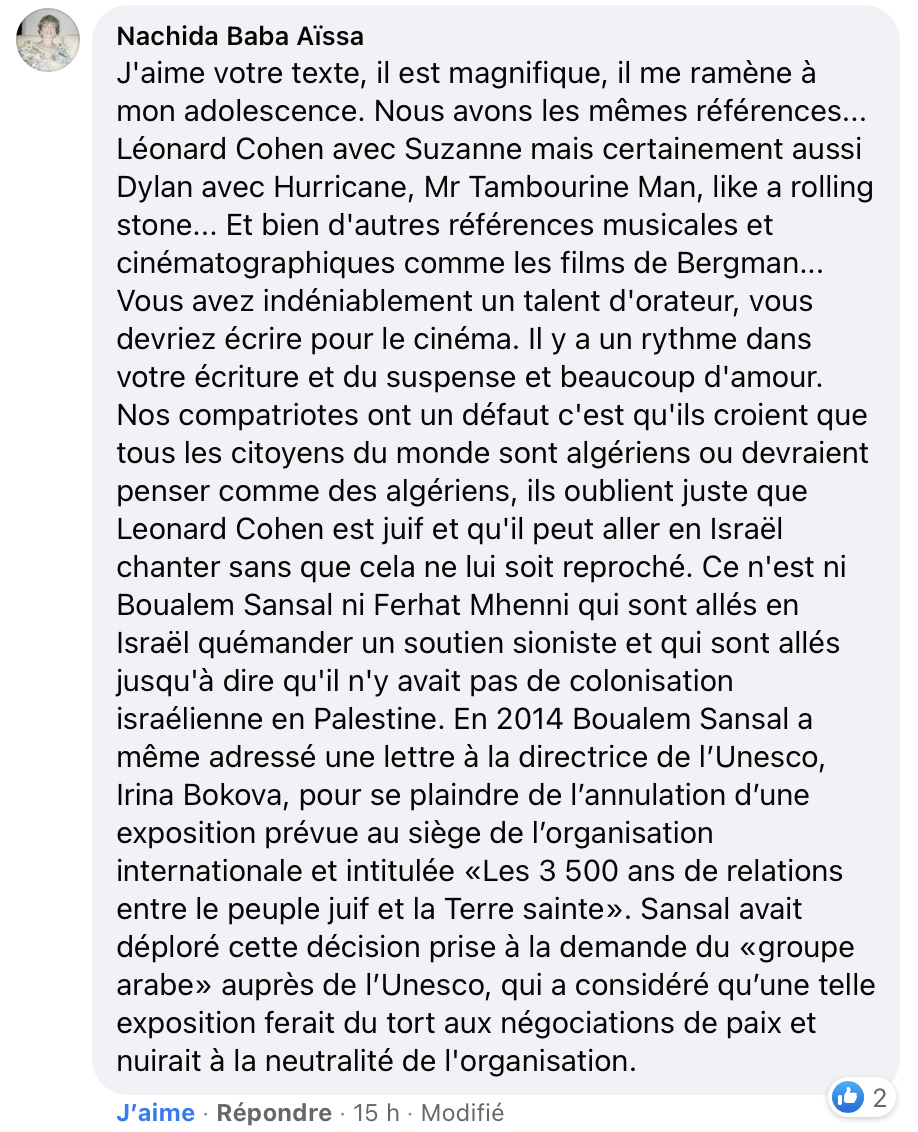




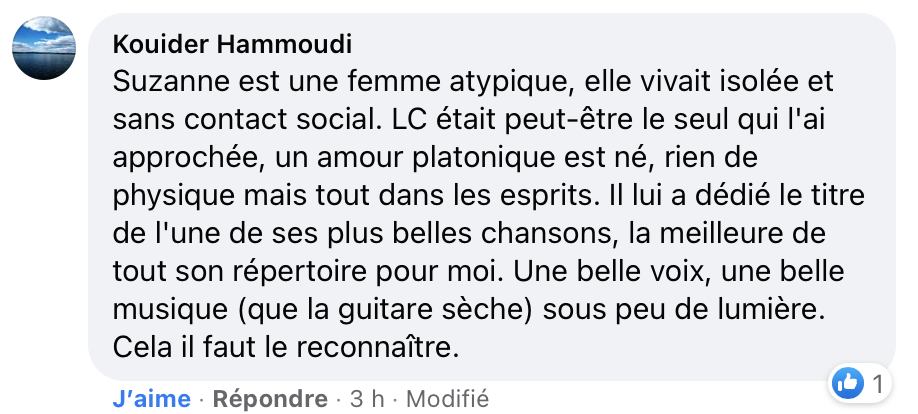
Il y eut des réactions quant à la proximité de Léonard Cohen avec l’état (colonial) d’Israël. Je ne les ai pas reprises ici, car mon propos se veut axé sur la poésie, la chanson, la littérature, le souvenir d’une époque… Nous savons tous les ravages de l’État d’Israël et nous savons que beaucoup de chanteurs, écrivains… sont proches de lui hélas, mille fois.
_____________________________________
Suzanne takes you down to her place near the riverYou can hear the boats go byYou can spend the night beside herAnd you know that she’s half crazyBut that’s why you want to be thereAnd she feeds you tea and orangesThat come all the way from ChinaAnd just when you mean to tell herThat you have no love to give herThen she gets you on her wavelengthAnd she lets the river answerThat you’ve always been her lover Etc.
____________________________________
LES PAROLES
(en français = de Graeme Allright°
Suzanne takes you down to her place near the river
Suzanne t’emmène chez elle près de la rivière
You can hear the boats go by
Tu peux entendre les bateaux voguer(1)
You can spend the night beside her
Tu peux passer la nuit auprès d’elle
And you know that she’s half crazy
Et tu sais qu’elle est à moitié folle
But that’s why you want to be there
Mais c’est pour ça que tu veux rester
And she feeds you tea and oranges
Et elle te nourrit de thé et d’oranges
That come all the way from China
Qui ont fait tout le chemin depuis la Chine
And just when you mean to tell her
Et juste au moment où tu veux lui dire
That you have no love to give her
Que tu n’as aucun amour à lui donner
Then she gets you on her wavelength
Elle t’entraîne dans ses ondes
And she lets the river answer
Et laisse la rivière répondre
That you’ve always been her lover
Que tu es son amant depuis toujours
And you want to travel with her
Et tu veux voyager avec elle
And you want to travel blind
Et tu veux voyager les yeux fermés
And you know that she will trust you
Et tu sais qu’elle aura confiance en toi
For you’ve touched her perfect body with your mind.
Car tu as touché son corps parfait avec ton esprit.
And Jesus was a sailor
Et Jésus était un marin
When he walked upon the water
Quand il marchait sur l’eau
And he spent a long time watching
Et il passa très longtemps à observer
From his lonely wooden tower
Du haut de sa tour solitaire en bois
And when he knew for certain
Et quand il eût la certitude
Only drowning men could see him
Que seuls les hommes sur le point de se noyer pouvaient le voir
He said All men will be sailors then
Il dit tous les hommes seront des marins alors
Until the sea shall free them
Jusqu’au moment où la mer les libérera
But he himself was broken
Mais lui-même fut brisé
Long before the sky would open
Bien avant que le ciel ne s’ouvre
Forsaken, almost human
Abandonné, presque humain
He sank beneath your wisdom like a stone
Il sombra sous ta sagesse comme une pierre
And you want to travel with him
Et tu veux voyager avec lui
And you want to travel blind
Et tu veux voyager les yeux fermés
And you think maybe you’ll trust him
Et tu penses que peut-être tu lui feras confiance
For he’s touched your perfect body with his mind.
Car il a touché ton corps parfait avec son esprit.
Now Suzanne takes your hand
Maintenant Suzanne prend ta main
And she leads you to the river
Et te conduit à la rivière
She is wearing rags and feathers
Elle est vêtue de haillons et de plumes
From Salvation Army counters
Venant des guichets de l’Armée du Salut
And the sun pours down like honey
Et le soleil coule comme du miel
On our lady of the harbour
Sur notre dame du port
And she shows you where to look
Et elle t’indique où regarder
Among the garbage and the flowers
Au milieu des déchets et des fleurs
There are heroes in the seaweed
Il y a des héros dans les algues
There are children in the morning
Il y a des enfants dans le matin
They are leaning out for love
Ils s’inclinent par amour
And they will lean that way forever
Et ils s’inclineront ainsi pour l’éternité
While Suzanne holds the mirror
Pendant que Suzanne tient le miroir
And you want to travel with her
Et tu veux voyager avec elle
And you want to travel blind
Et tu veux voyager les yeux fermés
And you know that you can trust her
Et tu sais que tu peux lui faire confiance
For she’s touched your perfect body with her mind.
Car elle a touché ton corps parfait avec son esprit.
(1) littéralement passer ( mais fallait éviter la répétition de passer )
Merci à : w.lacoccinelle.net
_____________________________
Et sa muse, la connaissez-vous ? Vous ne connaissez pas Suzanne VERDAL ?
Suzanne Verdal la muse de Léonard Cohen
Suzanne, la femme qui fit chanter Leonard Cohen
le 13 novembre 2016,
(modifié le 21 juin 2017)
La légende folk Leonard Cohen s’est éteinte jeudi. Cohen devait son tube planétaire à une danseuse hippie de Montréal, Suzanne Verdal, qui l’obséda toute sa vie.
Leonard Cohen est mort jeudi. (Reuters)
A-t-elle écouté son dernier album, You Want It Darker, chant funéraire paru il y a trois semaines? C’est peu probable. Écouter Leonard Cohen lui était devenu insupportable. Pourtant, qui d’autre connaissait mieux la légende folk, le plus sérieux concurrent de Bob Dylan, qui s’est éteint jeudi à l’âge de 82 ans? Justement, Suzanne Verdal le connaissait peut-être un peu trop. Le chanteur lui doit son premier succès et probablement la plus belle histoire d’amour de ce séducteur impénitent. Plutôt que de lui offrir son corps, la femme qui survit aujourd’hui avec ses rêves hippies dans un cabanon au bord du Pacifique, lui a inspiré la chanson qui restera à jamais associée à son œuvre.
« Je touchais son corps parfait par l’esprit »
L’histoire de Suzanne commence au début des années 1960. Poète et écrivain sans le sou, Leonard Cohen retrouve au Vieux Moulin, un club de jazz de Montréal, son ami, le sculpteur Armand Vaillancourt, dont la complicité avec sa très jeune fiancée sur la piste de danse le fascine. Trois ou quatre ans passent. Son ami a divorcé de sa danseuse. À l’été 1965, Leonard Cohen décide de rendre visite à la belle dans la maison au bord du fleuve Saint-Laurent, où elle élève seule sa fille, Julie.
Dans les rues de Montréal, ils se promènent à l’unisson, allument des bougies à l’église Notre-Dame-de-Bon-Secours. Chez elle, Suzanne lui offre du thé venu de Chine. « Nous n’avons jamais été amants sur un plan physique s’entend, c’était beaucoup plus profond que cela. Vous savez combien Leonard est un homme sexuel! Il est très attirant pour les femmes et je ne voulais pas être une de plus dans la foule », confiera Suzanne Verdal. « C’était un loft à une époque où l’on ne connaissait pas l’existence de ce mot. Elle m’a invité en bas à prendre du thé avec des zestes d’orange dedans. Les bateaux passaient devant les fenêtres et je touchais son corps parfait par l’esprit, faute de pouvoir faire autrement », racontera Leonard Cohen.
La chanson naît d’abord sous forme d’un poème, Suzanne Takes You Down. Quand le chanteur le psalmodie à Judy Collins au téléphone, elle lui demande d’en faire une chanson qu’elle enregistre en premier. Puis Suzanne ouvre en 1967 le premier album de Leonard Cohen, Songs of Leonard Cohen, avec pour autre succès, So Long Marianne, inspirée par Marianne Jensen, encore une ex-épouse d’un de ses amis artistes, avec laquelle Leonard Cohen vivra. Mais les histoires qui se concrétisent n’ont pas le privilège de l’éternité. Leonard Cohen rencontrera une autre Suzanne (Elrod), avec qui il aura deux enfants. La première devient un classique, bientôt repris par les compagnes et muses de Bob Dylan, Joan Baez et Françoise Hardy, mais aussi plus tard par la chanteuse de Abba, Anni-Frid Lyngstad, Graeme Allwright ou Alain Bashung. Leonard Cohen comparera sa Suzanne à un Château Latour de 1982.
Elle devient sans-abri à Los Angeles
À la fin des années 1970, Leonard Cohen se produit à Minneapolis. Suzanne Verdal s’est acheté un billet et vient le voir dans les coulisses à la fin du concert. « Tu m’as offert une belle chanson », la remercie le chanteur, devenu une superstar. Celle qui a voyagé de San Francisco à New York via Paris est retournée vivre à Montréal, où elle élève trois enfants de trois pères différents, toujours seule. Vingt ans après l’été 1965, Leonard Cohen est lui aussi à Montréal, où il reprend ses promenades lorsqu’il aperçoit sur la place Jacques-Cartier un spectacle de rue. Il s’approche, la danseuse le remarque. C’est Suzanne qui se présente à lui en mimant une révérence. Brutalement, il tourne les talons. On ne saura jamais pourquoi et s’il l’a reconnue ou bien ignorée.
En 1999, la danseuse tombe d’une échelle. Dos et poignets brisés. L’ancien rayon de soleil du Vieux Moulin ne peut plus enseigner la danse et sombre dans la dépression. Sa chanson la poursuit jusque dans les restaurants, qu’elle quitte dès qu’elle en entend les premières notes. Sans aucune ressource, elle est sans-abri à Los Angeles, survivant sur un parking de Venice Beach. L’eau toujours devant soi mais sans amour. L’ancienne fille qui faisait tourner la tête à toute la Beat Generation ne se doute pas que son ancien prétendant a déménagé à quelques kilomètres. Il vit dans un monastère bouddhique sous le nom de Jikan.
Ils ne se reverront plus jamais. En 2008, Leonard Cohen reprend la route, ruiné par sa manageuse mais sauvé par Suzanne. La vraie n’écoute plus la chanson, mais a gardé les mêmes « haillons », ce manteau de bohème qu’elle n’a jamais quitté.
Source: JDD papier
www.lejdd.fr
 La séance s’ouvre sur une question du cheminement entre les différents ouvrages écrits par l’autrice. « La question de la trajectoire est une question complexe. Le point de départ qui est sûrement partagé par de nombreuses personnes, c’est le sentiment de la privation dans les deux sens du terme, être dans un espace domestique, familiale il y avait quelque chose qui paraissait complexe à cet endroit-là… et il y avait aussi la notion du sentiment d’être privé et aspiration à devenir publique au sens d’aspiration à faire des choses qui revêtent un caractère collectif, quelque chose qui relève d’une certaine forme d’utilité ou d’une certaine forme de réponse aux nécessités qui pouvaient être les miennes quand j’avais 17 - 20 ans. Beaucoup de choses se forment à ce moment-là et en tant que jeune fille de l’immigration post-coloniale comme je peux l’expliquer dans ce récit, la question scolaire était une question assez importante, assez centrale et l’écriture a fait naturellement au regard de la place que prennent les écritures scolaires quand on est enfant puis adolescent, la question de l’écriture a pris une place importante mais aussi parce que l’écriture c’est quelque chose d’assez paradoxal au sens où en France c’est très fortement érigé comme une sorte d’art suprême, mais c’est aussi un art plus accessible que peuvent l’être d’autres formes d’expressions artistiques qui exigent des instruments, qui exigent des cours, qui exigent une maîtrise technique.
La séance s’ouvre sur une question du cheminement entre les différents ouvrages écrits par l’autrice. « La question de la trajectoire est une question complexe. Le point de départ qui est sûrement partagé par de nombreuses personnes, c’est le sentiment de la privation dans les deux sens du terme, être dans un espace domestique, familiale il y avait quelque chose qui paraissait complexe à cet endroit-là… et il y avait aussi la notion du sentiment d’être privé et aspiration à devenir publique au sens d’aspiration à faire des choses qui revêtent un caractère collectif, quelque chose qui relève d’une certaine forme d’utilité ou d’une certaine forme de réponse aux nécessités qui pouvaient être les miennes quand j’avais 17 - 20 ans. Beaucoup de choses se forment à ce moment-là et en tant que jeune fille de l’immigration post-coloniale comme je peux l’expliquer dans ce récit, la question scolaire était une question assez importante, assez centrale et l’écriture a fait naturellement au regard de la place que prennent les écritures scolaires quand on est enfant puis adolescent, la question de l’écriture a pris une place importante mais aussi parce que l’écriture c’est quelque chose d’assez paradoxal au sens où en France c’est très fortement érigé comme une sorte d’art suprême, mais c’est aussi un art plus accessible que peuvent l’être d’autres formes d’expressions artistiques qui exigent des instruments, qui exigent des cours, qui exigent une maîtrise technique.